Hubert-Félix Thiéfaine fait oublier Bob Dylan (+ extraits vidéo)
Palais Omnisports de Paris-Bercy - samedi 22 octobre 2011
Je perçois bien ce que le titre de cette note d'après-concert pourrait avoir de vaguement sacrilège. Comment ? L'icône de la protest song, celui dont on s'est plu récemment à faire courir le nom pour l'attribution du Nobel de littérature, Bob Dylan, donc, éclipsé par Hubert-Félix Thiéfaine, illustre Français méconnu, incorrigible amateur de cancoillotte et chantre repenti de la Ganja ? C'est que le passage de "HFT" au Palais Omnisport de Bercy, ce samedi, ne souffre aucune comparaison : au Bob Dylan en demi-teinte que nous avons applaudi avec force loyauté quelques jours auparavant, Hubert-Félix Thiéfaine, avec ce lyrisme un peu rentré qu'on lui connaît, cette inapaisable fêlure qu'il trimballe par devers lui, a donné une authentique leçon. D'ailleurs, si j'avais déjà connu Bercy survolté, c'est bien la première fois que je vois Bercy debout, entendez tout Bercy, fosse et gradins. Deux heures trente durant, celui qui, à soixante-trois ans, sort d'une épreuve dont il ne cache pas ce qu'elle a eu ou aurait pu avoir de définitif, a donné à beaucoup l'impression de ressusciter sous les yeux d'un public qui n'en espérait pas tant.
Dans le sas qui mène à la fosse, les choses avaient bien commencé : cela sentait bon l'herbe tendre, de Provence et d'ailleurs. Nostalgie d'un temps d'avant les lois de l'hygiénisme sanitaire et social et à laquelle les organisateurs ne peuvent pas grand-chose, si ce n'est, pour la forme, se fendre au micro d'un rappel à l'ordre déjà résigné. Les choses vont très vite : on sait d'emblée, dès les premiers accords, que c'est réussi ; ce sont des choses que l'on sent : une manière de s'installer sur la scène, de cristalliser l'entente entre les musiciens, de regarder la salle, d'être immédiatement dans sa voix. Pour ne rien dire de la qualité d'un son dont, il est vrai, n'ont joui ni Mark Knopfler, ni Bob Dylan, quelques jours plus tôt. Thiéfaine n'a pourtant pas spécialement facilité les choses en commençant son récital par un titre très peu connu, mais très beau, long, grave et hypnotique, Annihilation (Qui donc pourra faire taire les grondements de bête / Les hurlements furieux de la nuit dans nos têtes.) Thiéfaine réussit là où tant d'autres échouent car il semble ne jamais éprouver le besoin de se distinguer. Son génie, car c'est bien de cela qu'il s'agit, n'a pas besoin de se donner des apparences. Thiéfaine est sur scène comme on s'imagine qu'il est depuis à peu près toujours, pudique, troublant, habité, d'une théâtralité qui n'est pas de spectacle mais de métaphysique. Et s'il faut bien reconnaître que son public est, au bas mot, hétéroclite, qu'il a lui aussi sa part de dingues et de paumés, rien ne fait oublier à Thiéfaine l'origine de son chant.
Car Thiéfaine est un bloc. Est-ce, au fond, sa musique, toute sa musique, que l'on aime ? ou n'est-ce pas plutôt que nous nous sommes sentis, dès l'adolescence, en collusion immédiate avec ces univers viscéraux, opaques, abscons, prophétiques et surréalistes en diable, volontiers morbides, obstinément réfractaires à toute taxinomie. Le public, dans son immense majorité, ce soir comme tous les autres soirs, écoutait déjà Thiéfaine il y a vingt ou trente ans de cela ; et si les deux derniers albums ont probablement élargi un peu son audience, c'est pour toucher un auditoire qui n'est probablement pas thiéfainiste : je veux dire par là qu'il n'adhérerait pas aussi spontanément, pour des raisons qui tiennent autant à l'évolution des goûts qu'à l'esprit du temps, à ses premiers albums. Le fil rouge est là pourtant : du Chant du fou (1978) à La ruelle des morts (2011) en passant par Alligator 427 (1979) ou Soleil cherche futur (1982), il s'agit du même ressassement lyrique, de la même sonde jetée à la face de la même part fêlée de l'humanité. Que Thiéfaine s'exprime en musique est une chose, mais on ne peut le dire ainsi que si on a conscience de la vision du monde qui s'y joue. D'ailleurs sa musique est-elle trop touffue, trop imbriquée, trop mêlée pour se laisser piéger au carcan du registre ; du rock, du blues, de la folk, il aime certainement cette pulsation unique et centrale et roborative qui charrie l'abandon, l'hypnose, la méditation organique ; aussi sa musique est-elle aussi profondément littéraire que ses textes : il s'agit bien, par une voie ou une autre, par le rythme ou par le verbe, d'investir la langue de l'humain, de jouer de ses élasticités, de renvoyer à l'univers son goût de cendre, de brumaille et d'hébétude.
Ce qui permet peut-être de comprendre pourquoi chaque concert de Thiéfaine ressemble toujours un peu à une rétrospective : non de sa carrière mais de sa trajectoire, de son existence. Que le dernier album - qui n'est pas mon favori, mais peu importe - soit largement évoqué (Fièvre résurrectionnelle / Infinitives voiles / Petit matin 4.10 heure d'été / Garbo XW machine / Ta vamp orchidoclaste / La ruelle des morts / Les ombres du soir / Lobotomie Sporting Club), cela ne représente jamais qu'un tiers du concert. Et si le public célèbre le culte de Loreleï Sebasto Cha ou de La fille du coupeur de joints, c'est bien sûr pour éprouver le plaisir un peu grégaire de la communion, mais c'est aussi parce qu'il sait que ces chansons-là sont devenues bien plus que des chansons : des rituels, des butées, des repères, des balises posées sur le kaléidoscope de l'existence. Thiéfaine les chante avec la même naïveté intacte, la même énergie lasse, cela réveille toujours en lui ce qui ne bouge pas, qui ne s'altère pas, ce temps où il eut l'énergie, donc, d'écrire ces chansons qui sont aussi incongrues qu'elles sont devenues populaires, aussi désinvoltes d'apparence qu'ancrées dans un certain imaginaire.
Qu'est-ce qu'un concert mémorable ? Etant entendu que se joue toujours, lors de tout concert, autre chose qu'une seule réussite musicale ou technique : c'est toujours un passage à l'acte ; non une épreuve, mais une mise à l'épreuve de soi-même. D'aucuns y font peut-être face avec nonchalance ou désinvolture - le temps les oubliera. Pour une personnalité comme celle d'Hubert-Félix Thiéfaine, on peut imaginer que son expérience de la scène, si elle atténue peut-être certaines angoisses (et encore cela vaudrait-il la peine d'être vérifié), ne change rien au fait qu'il y engage toujours beaucoup. Il ne s'agit pas tant de contenter un public qui à payé pour cela que de se rappeler à soi-même la relative gravité, au moins l'importance de chaque chose. Thiéfaine est de ces artistes (ce en quoi d'ailleurs il en est un, et parmi les plus grands) qui ne cherchent pas sur scène à prouver ou à justifier leur condition d'artiste, mais qui continuent à vouloir y sublimer la mélancolie, l'incomplétude, les affres, pourquoi pas, de l'existence. Bien sûr, il y a du spectacle. Bien sûr, il y a des lumières, des fumées, des effets. Mais c'est comme si même Thiéfaine ne les voyait pas, comme s'il passait par-dessus. Il chante la mort, les fous, les dépendances, les trous noirs et la société, et il chante toujours pour la première fois car il a en lui la puissance fragile et délicate et taraudée du poète. Le moment, évidemment touchant, où il entonne Mathématiques souterraines avec son fils Lucas (souvenez-vous de Tita Dong Dong Song : "Lucas look at me"), dévoile une joie discrète, mêlée de fierté paternelle et de pudeur personnelle ; cela aurait pu être lacrymal, et après tout, le meilleur des publics a bien droit à sa sensiblerie. Seulement, voilà, rien, chez Thiéfaine, n'est jamais clinquant, rien n'est jamais inélégant. Thiéfaine est passé à travers l'exhibitionnisme du temps, il est celui qui peut s'enorgueillir de remplir Bercy (ou peu s'en faut) tout en sanctuarisant son art, celui qui peut transformer chacun ou presque de ses disques en disques d'or sans que jamais aucune lubie ne le fasse dévier de son chemin d'airain. Ce n'est pas pour cela qu'il s'est agi d'un concert exceptionnel mais, sans cela, sans cet état d'esprit-là, il n'aurait été qu'un très grand concert.
1er extrait : Entrée sur scène / Annihilation
Hubert-Félix Thiéfaine - Entrée sur scène + Annihilation - Bercy, 22/10/2011
2ème extrait : Loreleï Sebasto Cha
Hubert-Félix Thiéfaine - Lorelei Sebasto Cha - Bercy, 23/10/2011
3ème extrait : Le chant du fou
Hubert-Félix Thiéfaine - Le Chant du Fou - Bercy, 22 octobre 2011
4ème extrait : Confession d'un never been
Hubert-Félix Thiéfaine - Confession d'un never been
5ème extrait : Mathématiques souterraines (avec Lucas Thiéfaine)
Hubert-Félix Thiéfaine (et son fils Lucas) - Mathématiques souterraines
6ème extrait : Autorisation de délirer / Alligators 427
Hubert-Félix Thiéfaine - Autorisation de délirer / Alligators 427
7ème extrait : La fille du coupeur de joints

/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)


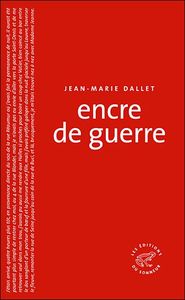






 Q
Q
/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)