Nathalie Ménigon, coupable à vie éternelle
À ceux qui estiment (ils sont nombreux, à en croire les enquêtes complaisamment diligentées) que la justice de ce pays est excessivement clémente, qu'elle fait la part trop belle aux escrocs, aux violeurs de petites filles et aux massacreurs de vielles dames, bref les salauds génériques dont ont besoin l'ordre civilisationnel pour se maintenir et une partie de la classe politique pour fidéliser ses ouailles terrorisées, il faut parfois tirer un peu les oreilles (afin de pouvoir y gueuler plus à notre aise et y faire entendre quelques bruits d'eau un peu différents).
Dans un très remarquable mouvement d'indépendance idéologique qui ne troublera que les benêts et les sceptiques, le Parquet de Paris s'est donc prononcé contre la demande de suspension de peine pour raisons de santé de Nathalie Ménigon, ancienne membre d'Action Directe (précisons toutefois, à la décharge du Parquet, que la loi lie celui-ci aux conclusions de deux expertises contradictoires qui, lorsqu'elles aboutissent à de semblables conclusions, s'imposent à lui ; ainsi ai-je en tête ce cas, que l'on m'a rapporté, d'un détenu atteint concurremment d'hépatite C, du sida, de neuropathie aggravée et de tuberculose, et dont les experts ont considéré que l'état n'était pas incompatible avec l'incarcération : tout juste ont-ils regretté que les escaliers de la prison l'empêchaient d'accéder au parloir avocat...). Bref. Les moins informés seront sans doute heureux d'apprendre que Nathalie Ménigon, quarante-neuf ans, condamnée à deux reprises à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de dix-huit ans, est partiellement hémiplégique. Le précédent de Joëlle Aubron (comparse de Nathalie Ménigon, pour utiliser le vocabulaire vicieux de la grande presse), qui était atteinte d'un cancer et avait pu bénéficier in extremis d'une suspension de peine pour décéder moins de deux ans plus tard à l'âge canonique de quarante-six ans, n'aura donc pas fait d'émules.
Si je comprends bien, il semble que ledit Parquet et/ou les experts qui y sont attachés considèrent donc, de deux choses l'une :
- soit que l'hémiplégie dont est atteinte Nathalie Ménigon n'est pas grave, en tout cas bien moins grave que le cancer de Joëlle Aubron, et que les soins prodigués en prison sont d'une qualité telle (c'est bien connu) qu'on puisse en conscience l'y laisser (mourir) ;
- soit que Nathalie Ménigon constitue, nonobstant son hémiplégie, un tel danger pour la cohésion du pays très républicain qu'il ne saurait être question de la libérer et, ce faisant, faire courir à la France le risque d'une guerre civile.
L'argument est partout entendu, mais au moins a-t-il le mérite de l'évidence : une partie de la justice considère donc que Nathalie Ménigon demeure un danger public (au moins) plus important que Maurice Papon en son temps, condamné comme chacun sait pour complicité de crime contre l'humanité et libéré pour raisons de santé. Étonnamment, la fameuse "jurisprudence Papon" semble trouver en France bien peu d'occasions à s'appliquer, alors même que des centaines de détenus souffrent de maladies dont tout un chacun sait bien qu'ils en mourront - qu'ils en crèveront serait plus juste.
Il est heureux que le Parquet n'ait pas tous les pouvoirs - quoiqu'il y aspire. Reste donc au juge d'application des peines à rendre sa décision : rendez-vous le 24 octobre. Jusque là, la France terrorisée peut dormir sur ses deux oreilles. Après...

/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)
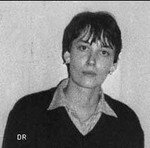


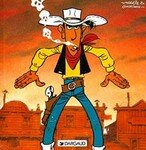
/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)