Le texte qui suit est un peu particulier. Il est signé Paméla Ramos, libraire et auteur d'un blog remarquable et singulier. Plusieurs semaines durant, j'ai noué avec Eric Bonnargent, alias Bartleby, un dialogue plein de curiosité et de complicité, au prétexte de converser sur la littérature et sur Internet. Ce dialogue, vous le retrouverez dans son intégralité en suivant ce lien (fichier pdf) : Dialogue
Sa publication suscite quelques débats assez passionnants, notamment sur le blog de Stéphane Beau, qui coordonne la revue Le Grognard. Mais il a aussi agacé quelques bloggeurs en vue, notamment Clarabel, qui trouva élégant d'y contribuer en déposant sur son blog une chanson à la mode intitulée Fuck you (sic), avant d'effacer finalement toute allusion à cet échange, et après que Joseph Vebret, directeur du Magazine des Livres, l'invita à faire valoir son point de vue. Il va de soi pourtant que notre intention, à Bartleby et à moi-même, ne fut jamais de blesser quiconque ; simplement, la notion même de débat induit parfois de trancher, de distinguer, de séparer. Mais, tout comme il peut y avoir des écrits caricaturaux, il peut y avoir des lectures caricaturales. Et précisément, réduire ce long entretien à un différend qui n'occupe pas même deux lignes d'un texte de près de trente pages, c'est tout de même un peu attristant ; quelles que soient par ailleurs les qualités des uns et des autres.
Et puis, hier, Eric "Bartleby" Bonnargent a reçu de Paméla Ramos le texte qui suit. C'est un texte dru, pressant, nerveux, et sa qualité nous a conduits, Eric et moi-même, à lui demander l'autorisation de le publier sur nos blogs respectifs. C'est chose faite désormais, et nous l'en remercions.

Je savais qu’ils étaient impuissants.
Roger Nimier, Les épées.
C’est cette maladie, ce fléau des âmes, cette entière subversion de probité et d’honneur que Scipion redoutait pour vous, quand il s’opposait aux théâtres ; quand il prévoyait quelle facilité l’heureuse fortune aurait à vous corrompre et à vous perdre […], car il ne croyait pas à la félicité d’une ville où les murailles sont debout et les mœurs en ruine.
Saint-Augustin, La cité de Dieu.
We think we’re important, but we’re not.
Un internaute, sur Myspace.
Et je te le dis, moi, Bartleby, in fine, tous ces démontreurs de talent, ces bateleurs du dimanche, je n’aime pas trop leur ton.
Je lis, cher Bartleby aux yeux si ouverts, cet entretien pharamineux qui tu me glisses innocemment dans la boîte aux lettres avant de le publier sur le site du Magazine des Livres, et sur ton blog propre dont je n’ai pas à répéter le bien que j’en pense, même si tout dessus ne m’intéresse pas. Tu me demandes, donc, mon avis (j’aurais pu te vouvoyer encore longtemps, car le respect se marque aussi par cette distance langagière, et le snobisme des lettrés de se taper dans le dos à la moindre occasion pour prouver leur décontraction me déroute quelque peu). Je vais te répondre par ce biais, il me permettra par la même occasion de dérouler une bonne fois ce que j’ai à en dire, de ce merveilleux monde des blogs littéraires ou de la littérature électronique (quelle horreur ! de voir ces mots accolés, mon cœur, échaudé mais toujours romantique, s’arrête). Ce que je pense d’écrire, dans une fausse simplicité, sur la Toile, ce théâtre des insanités, cachot des médiocres où l’on tabasse sans vergogne. S’il est vrai que nous ne nous faisons plus bouffer par les lions sous les rires de la populace, il faut se demander dans quelle mesure les violences psychologiques qu’engendrent les effusions écrites, et soi-disant virtuelles des uns et des autres ne sont pas tout aussi mortifères. Et diablement révélatrices de l’état de nos mœurs.
Qu’est-ce que je te disais, Bartleby, si Platon constate qu’il ne faudrait jamais écrire, je te le dis, moi, nous ne devrions jamais publier ! Où sont les Bartleby de la Toile, perclus dans leur silence, qui donc peut encore résister aux sirènes ?
Ils sont tous affolés par le sang qu’un bon mot répand dans leur arène moderne, ils s’arrachent l’os, fous et dangereux, l’os qui leur donne raison, sans aucun recul jamais, si prompts à faire entendre leur clameur indigne. Ils n’ont jamais assez travaillé, ni lu assez, et les voilà, pourfendeurs de la Sphère, fiers et crânes, empêchés dans leur cotte de maille tissée de leurs volontés sous-jacentes de pouvoir et de reconnaissance. Nos néo-Ridicules.
Je ne fais aucun commentaire, nulle part, sur cet entretien, même si certains m’échauffent considérablement. J’écris cette réponse. Je ne répondrais à aucun commentaire qu’un imprudent tentera ici de faire. J’exigerais une réponse.
J’ai versé, il a quelques années, mon sang et celui des autres dans ces échanges stériles des sites de réseaux sociaux, leurs névroses centrifuges, leur caractère sexuel palpable, et cette finalité générale : l’accès si fascinant aux immenses cabines de peep-show mal dissimulées derrière des profils « innocents ». On n’apprend jamais mieux que de ses erreurs. L’insanité, l’incurie éclaboussent nos écrans, la nausée, le dégoût sont partout, les blessures jamais à même de se refermer tranquillement. On m’opposera que j’ai eu des expériences malheureuses, et indignes. On jettera alors la première pierre. Je sais qu’ici déjà, Bartleby, nos opinions diffèrent.
Mon exigence première, à présent, est de travailler ce que je régurgite sur un blog que je n’impose à personne, que je ne promeus nulle part. Pour mieux voir évoluer ma pensée et mes goûts, comme exercice littéraire libérateur et peut-être même salvateur. Ma deuxième exigence est de ne lire que ceux et de ne répondre qu’à ceux qui s’expriment bien.
Si cette exigence est prétentieuse, si cette exigence est élitiste, si cette exigence est fasciste, c’est parce que nos bons réactionnaires d’internautes ne prennent plus leur dictionnaire avant de libérer des mots en commentaires qui, malheureusement et quoi qu’on en dise, restent.
 Je suis libraire depuis plus d’un an maintenant, bibliophile à mes heures, je côtoie l’édition de bien près, même si ma connaissance des pratiques réelles reste parcellaire puisque tout, encore une fois, ne m’intéresse pas dans ces champs de mines, mais surtout, surtout, unique et farouche fierté dans tous ces étalages : je lis. Je n’arrête jamais de lire, sauf quand il faut frapper quelques mots malhabiles sur ce clavier maudit.
Je suis libraire depuis plus d’un an maintenant, bibliophile à mes heures, je côtoie l’édition de bien près, même si ma connaissance des pratiques réelles reste parcellaire puisque tout, encore une fois, ne m’intéresse pas dans ces champs de mines, mais surtout, surtout, unique et farouche fierté dans tous ces étalages : je lis. Je n’arrête jamais de lire, sauf quand il faut frapper quelques mots malhabiles sur ce clavier maudit.
Je prends la discussion en cours, j’en conviens. Entre deux portes, je t’arrache par la manche pour que tu m’expliques mieux. J’écoute. Je n’opine pas toujours, et me sens violemment concernée, alors voici ma modeste réponse. Modeste, en vrai, elle ne l’est pas, car c’est tout entière qu’elle me mobilise, et me définit. Infâme réponse, en tout cas, dans le sens réel, étymologique du terme.
Il est des personnes qui s’accomplissent en se donnant, d’autres en s’érigeant en leaders, pour ma part j’aime soutenir, forte, rageuse ou patiente, mais en dessous. Les livres, de leur poids symboliques et réels s’empilent sur mes épaules, je ne crains pas d’en rajouter, non plus que d’en dégager violemment les indésirables, les imposteurs, les injustes, car après tout, les forces ne sont pas inépuisables. Il en va de même pour certains individus, qui n’ont certes pas toujours besoin de soutien, mais qu’il me plaît, à mon niveau, d’encourager et d’applaudir. Des individus comme toi, par exemple, en ce moment-même. Je n’ai aucune difficulté à choisir mes camps, et à camper des positions parfois intenables, puisque avant même d’être raisonnées, ces positions sont viscérales. Leur degré de cohérence générale m’indiffère. Je ne crois de toute façon ni être terminée et construite parfaitement en systèmes indéboulonnables, ni le souhaiter parfaitement.
Je commence à voir fleurir ça et là des « réactions » à tes propos. Je crois que je les déteste plus encore qu’un mauvais livre, qui lui, a été écrit, quoiqu’on en dise. Je n’aime rien de moins que cette possibilité, donnée par la Toile et la Toile seule, aux médiocres, car ils existent et se reconnaissent, de venir empoisonner et perquisitionner sans relâche chez les meilleurs, car ils existent et se reconnaissent, avec une volonté mal assumée d’attirer l’attention sur leurs vociférations de ménagères. Et donc d’encourager, tout en pensant la fustiger, la prolifération de la médiocrité ambiante et des idées réactionnaires.
Donner à tous la possibilité de donner leur avis sur tout, tout le temps, est une farce macabre qui nous entretue plus ou moins lentement, nous assèche, nous vide, dans des polémiques creuses et des débats improbables entre un individu qui ne connait que sa sagesse populaire et s’en munit comme d’un cadeau spontané et véritable des dieux et celui qui dégaine ses auteurs morts pour légitimer ses propos. Cette agitation est une honte. La moindre des choses alors, pour aller au bout du procédé, serait que chacun prenne un blog, et je veux dire vraiment, qu’il connaisse la solitude de lire et d’écrire en se regardant faire, avec ses doutes et l’humilité première de comprendre, un peu plus longuement que dans trois lignes de commentaire, ce qu’il en coûte d’écrire et d’être lu, puis critiqué à son tour.
Je fais donc, par soutien, ce que tu viens de faire : je me dévoile un peu, et tente de montrer mon jeu sur une table déjà bien encombrée par une multitude de cartes.
Tu jugeras sur pièces.

CHRONOPHAGIE FRENETIQUE
Il y a tout d’abord dans votre échange prolixe un facteur qui n’est jamais cité, celui à mon sens d’où dérive la sinistre condition de scribe moderne pour peu qu’il ait mis un doigt sur la Sphère : le facteur chronophage. Cette frénésie des interactions, qui nous bouffe tout le temps que nous devrions prendre à réfléchir, loin de la réaction inféconde, qui se veut immédiate comme si c’était un argument de sa valeur, comme si d’asséner le dernier mot devait nous protéger d’avoir tort. Il est difficile, après labeur et réflexion de donner à lire n’importe quel texte qui se tienne et quel qu’en soit le sujet. Mais alors renouveler l’exploit plusieurs fois par semaines, ou même par mois pour les plus rares, c’est une folie douce ! Nous sommes tous pris dans l’engrenage d’en donner toujours plus, quitte à sacrifier à la qualité ou la relecture, et la rareté dont tu fais preuve t’honore mais te décale dans un même temps de la partition. Ce n’est pas une mince affaire de se tenir, borné, à l’écart des standards, et de publier peu, mais bien et longuement. Gageons que sans même toujours que tu le saches, la cadence générale du net accélère ton pas en te talonnant ferme.
Je n’ai donc jamais cru que le texte destiné à être livré sur la Toile, par les vecteurs du site ou du blog, des commentaires ou même de simples mails ne constituait autre chose que du bavardage. Ensuite alors, il y a ceux qui s’expriment bien, clairement et à renfort d’expérience ou d’érudition, et ceux qui pépient ou jacassent, polluant nos rétines, volant tout notre temps de leur voix inutile. Si l’on avait du moins la modestie de lever le dernier tabou autour du texte, et d’assumer clairement que nous pouvons très bien parler de ce que nous ne connaissons pas, de ce que nous n’avons pas lu et ne lirons pas, ou pas intégralement, alors ce facteur chronophage serait moins dangereux. Je ne passerais pas mon temps à collecter ici et là des indices et même preuves de l’imposture démocratique de nous faire croire que nous pouvons tous écrire (mais de cela j’en suis convaincue) et publier (et alors là, je m’étrangle), que chaque voix est importante. Non, elle ne l’est pas. Vois par toi-même la rage qu’il en coûte d’avoir perdu ses heures dans les salons virtuels d’imbéciles prétentieux, dont tu penseras peut-être à juste titre que je fais partie. Ils étouffent et condamnent l’accès aux voix intelligentes, comme celle de ce Marc Villemain, cet interlocuteur digne et précis que tu choisis à merveille, et dont j’aurais préféré mille fois connaître les écrits avant ceux de bien d’autres (je ne diffamerai pas ici, excusez ma lâcheté, mes heures sont encore trop précieuses pour répondre aux affligés).
Si la littérature est bien un art lent et le dernier probablement, alors elle ne peut pas longtemps résister aux assauts de la Toile. Voyez comme il faut la nourrir, la Cybèle insolente ! Alors déjà, je me dissocie de toute mythologie consistant à nous assurer qu’il existe, sur cette Toile, une littérature. Quand bien même, accidentellement, le miracle de la création pouvait se dérouler sous nos yeux ébahis, le support même ne se prête guère à une possession jalouse et secrète de l’objet-livre, dont je me pose éternellement comme gardienne, bien qu’inquiète vraiment car ces cons-là vont bien finir arriver à nous le faire disparaître, avec leur apologie systématique et sans recul des nouvelles technologies, des nouveaux – mot à la mode, « supports ».
 Je vais te dire, maintenant, après une brève réponse aux attaques d’élitisme dont tu commences à souffrir, ce que je sais, moi, de ces miroirs du monde du livre, si ma parole a une chance, et une seule d’avoir un peu d’intérêt pour toi, et d’autres.
Je vais te dire, maintenant, après une brève réponse aux attaques d’élitisme dont tu commences à souffrir, ce que je sais, moi, de ces miroirs du monde du livre, si ma parole a une chance, et une seule d’avoir un peu d’intérêt pour toi, et d’autres.
Tu me disais récemment « Attention, les gens n’aiment pas la vérité. » Je réponds très crânement que je n’aime pas « les gens », anonymes inconnus, que je me soucie peu de leur avis, confère ci-dessus. Ils n’existent pas en tant que tels. « Les gens », « la masse », « les autres » sont des appellations que nous autres individus paranoïaques, aimons à entretenir, mais sincèrement, aucun de ces flous regroupements ne s’incarne jamais véritablement. Sur la Toile, toujours, j’entends. L’avis d’individus que je connais par ailleurs, oui, me touchera et m’affligera ou me rendra plus forte. Ceux-là n’attendent pas après une note postée ici pour savoir depuis longtemps ce que je pense et y répondre. Je sais que tu parlais de ceux-là, mais j’en profite pour éclairer quelque peu la scène sur laquelle je prétends m’avancer, ce jour.
ELITISME vs POPULAIRE
On te dit élitiste ? Et alors ? Le bas peuple – je m’amuse donc, tu l’auras compris, de cette appellation, ne lit pas les blogs littéraires. Il lit les classements d’Amazon, et les suggestions croisées de lecture des robots du site de la Fnac (« ceux qui ont acheté tel ouvrage ont aussi acheté celui-là » Super, merci.)
Quand il les lit, c’est pour cette « vérification de lui-même » dont vous parlez fort bien dans l’entretien, jamais pour entrer en véritable collision et grandir par ce biais. Il veut vérifier qu’il lit bien les bons livres. Ceux dont on parle simplement et avec bonhomie, avec la certitude édénique et béate de se faire du bien. Mais grands dieux, doit-on toujours écrire pour tout le monde ? Pour ce peuple dont je doute, confère à nouveau ci-dessus, qu’il existe ?
Je te rejoins dans la volonté un peu austère de transpirer sur un livre, et d’y trouver la satisfaction intellectuelle de l’avoir, illusoirement, vaincu.
Et enfin, sur le fait qu’il existe, oui, des livres de divertissements, et des livres de génie. Steiner a aimé Harry Potter ? Mais grand bien lui fasse, je doute pourtant qu’Harry Potter ait réellement besoin du soutien qu’il lui porte. Je rejoins toujours Rivarol lorsqu’il affirme non sans provocation « Un livre qu’on soutient est un livre qui tombe ». Faut-il produire des communiqués démagogiques de soutien à ce qui ne tombe de toute façon pas, afin de rassurer ceux qui par souci constant et exclusif de bien-être assument (mal, sinon les réactions seraient moins hostiles) de ne rien lire de difficile, voire de perturbant ?
Question ouverte, mais enfin, on pourrait peut-être passer aux choses et attaques sérieuses.
Je reviendrai plus bas sur cette impérieuse vocation que se trouvent trop de scribes de la Toile d’éduquer les lecteurs, et de souhaiter propulser certains auteurs hors des rangs de l’anonymat. Là réside probablement et la plus grande illusion idéaliste, et la plus déraisonnable voire inconcevable entreprise.
L'ANGÉLIQUE LIBRAIRE ET LE DÉMONIAQUE ÉDITEUR
L’attaque élitiste a donc bon dos, vraiment et dissimule souvent son vrai visage : l’aigreur de n’être pas aussi intelligent que celui qu’on lit, et supporter mal de constater ses défaillances intellectuelles. C’est bien normal, car c’est désagréable, et ce qui est désagréable est nauséabond, tout effrayés que nous sommes d’être suspectés de collaboration à d’obscurs cultes sinistres si nous osons défendre l’inconfort.
Une critique fondée que te fait Marc Villemain, et que relaient, tout heureux de te trouver des faiblesses, toi qui commences à vraiment trop dépasser, nos chers internautes qui n’ont pas une fois envisagé, eux, de se coltiner le sale boulot de parler de ce qui fâche : un idéalisme certain de la chaîne du livre. Et pour une fois, je sais un peu de quoi je parle ici.
Faisons vite, car Villemain te répond assez sur ce point, et tu conviens toi-même à quelques reprises de l’étroitesse de tes à-priori.
La mythologie du libraire est tenace, et c’est agréable de nous voir ainsi investis de la mission divine de trier les ouvrages et de les transmettre à des clients avides de nos lumières. Agréable, mais pas honnête. Il existe des libraires heureux, et j’en fais partie, sans pour autant que cela soit pour les raisons que l’on pense. Je sonde mes collègues, mes amis de la même profession, mais ne me fais en aucun cas la porte-parole de cette congrégation, puisque ne croyant pas à ces regroupements hasardeux. Je parlerai alors uniquement de ma stricte connaissance de ce métier, et de ce que j’en entends par le peu de libraires que je connais personnellement.
Que nous ayons 20, 30 ou 60 ans, nous n’avons jamais lu les livres que nous vendons.
Je gère pour ma part plus de 11 000 références, et ma boutique est fort petite, et spécialisée majoritairement en histoire. Mais ce serait, malgré un nombre de lectures à mon actif dont je n’ai pas à rougir, exactement le cas dans une librairie de littérature générale.
Nous passons notre temps à répondre « Je ne sais pas », si nous sommes honnêtes, et si nous ne le sommes pas, la sentence ne tarde pas à tomber.
La triste vérité, c’est que nous ne savons pas, nous ne pouvons plus savoir ce que contiennent les livres que nous vendons. Une moyenne de 60 000 ouvrages paraît chaque année, en France. Si ce chiffre inclut les réimpressions, les nouvelles éditions et les parutions en poche, il n’empêche qu’il reste démesuré. Rien qu’en Sciences Humaines, la partie qui me concerne plus particulièrement, les publications oscillent en 3000 et 5000 nouveautés. Il existe actuellement plus de trois millions d’ouvrages disponibles, donc de « fonds » dans le jargon, les spécialistes me pardonneront cette précision. Je rappelle que d’en lire la simple liste prendrait 15 ans de notre existence. Ceci, pour dresser le contexte effrayant et ô combien humiliant dans lequel nous évoluons. Nous sommes les seuls commerçants, avec les pharmaciens, à devoir brasser un nombre aussi vertigineux de références. Et le seul domaine général (je parle ici du livre, pas de la simple librairie qui ne fabrique pas ces produits), tous confondus, à répondre à la folie furieuse de la surproduction par… la folie furieuse de la surproduction.
Nous ne savons plus rien, ce que nous savons de ces livres se noyant sans aucune chance de survie dans ce que nous ne savons pas.
Si, dans la journée, j’ai la chance ultime de répondre à un client sur le contenu d’un livre, qu’il m’écoute, l’achète, reparte satisfait, je peux considérer que ma mission est accomplie. Un client ! Deux, allez trois soyons fous. Par jour. Pas plus. Jamais !
La plupart du temps je lui dresse une bibliographie que je m’efforce de donner la plus complète possible, je lui indique où se trouve celui qu’il cherche, et lui donne des pistes de lectures sachant que je peux totalement me tromper, dans un équilibre terrifiant, car, et je ne leur en veux pas, c’est encore un scandale pour beaucoup que nous n’ayons pas lu les 11 000 titres qui se trouvent dans les lieux, quand ce n’est pas un miracle pour les autres, condescendants, que nous en ayons lus quelques uns et que nous osions alors porter dessus un avis toujours contestable.
Et l’œil le plus inquiet que nous portons est encore celui qui regarde le chiffre d’affaire. Une bonne librairie est d’abord une librairie ouverte, convenons-en une bonne fois pour toutes. Nous sommes tous tenus, plus ou moins certes, mais tous, à des impératifs économiques, et donc tous, et là à mon sens sans aucune distinction quantitative, corrompus par le fait même de vivre dans les cadres de la société telle qu’elle est tant que nous ne décidons pas de la renverser. Je ne vois personne renverser personne, présentement, mais je regarde peut-être mal.
Là encore, élevons le débat, par pitié. Je sais que tu as modéré tes propos sur l’économie du livre, mais je sais aussi par d’autres sources que beaucoup ne veulent toujours pas en convenir et cette mauvaise foi m’assomme.
 Et j’en viens maintenant à l’édition. Je crois tout à fait idéaliste d’opposer les majors aux indépendants. Et souhaiterais rappeler qu’il n’existe dans le paysage français, en littérature j’entends et à proprement parler, aucune indépendance de l’édition, puisqu’en remontant dans les concentrations et les rachats nous n’arrivons guère qu’à deux monopoles. Si l’éditeur est indépendant, encore faut-il qu’il soit distribué et là réside quelque problème. Je ne vais pas tenir ici un cours de politique éditorial qui serait grossier et trop rapide. Je t’engage si cela t’intéresse, à lire le numéro de la revue Esprit intitulé « Malaise dans l’édition », pour un exemple parmi d’autres.
Et j’en viens maintenant à l’édition. Je crois tout à fait idéaliste d’opposer les majors aux indépendants. Et souhaiterais rappeler qu’il n’existe dans le paysage français, en littérature j’entends et à proprement parler, aucune indépendance de l’édition, puisqu’en remontant dans les concentrations et les rachats nous n’arrivons guère qu’à deux monopoles. Si l’éditeur est indépendant, encore faut-il qu’il soit distribué et là réside quelque problème. Je ne vais pas tenir ici un cours de politique éditorial qui serait grossier et trop rapide. Je t’engage si cela t’intéresse, à lire le numéro de la revue Esprit intitulé « Malaise dans l’édition », pour un exemple parmi d’autres.
Seulement, excuse-moi, Bartleby, mais si nous jouissons de si diverses et innombrables parutions, c’est peut-être, sans vouloir me faire l’avocat du Diable qui se débrouille très bien tout seul, parce que ces fameux « méchants » industriels sont avant tout des amoureux du livre, ou en tout cas du prestige qu’il continue à engendrer, que tu le croies ou non, aux yeux des anonymes. Alors amoureux des mêmes Lettres que toi ou moi, certes pas toujours, mais l’intention, si elle n’est pas suffisante, est déjà un miracle.
Et tu sais la meilleure preuve ? Le secteur de l’édition littéraire ne rapporte rien ou si peu, c’est pour les grands groupes un boulet absolument peu rentable malgré les Lévy et consorts. Chaque maison, pour celui qui en tient le portefeuille, est une danseuse. Et l’équipe qui doit la faire tourner n’est jamais mue par autre chose que le désir de faire rayonner les livres qu’elle aime, tant les salaires sont bas et les horaires contraignants tout en sachant que d’un claquement des doigts du mécène amoureux, ils disparaissent et leurs livres aussi. 2% des salariés de l’édition jouissent de salaires prestigieux, quand les 98 % se débattent avec leurs titres honorifiques soit, mais peu lucratifs.
Parmi ces 2%, certains déshonorent leur profession, oui, mais plus par leur mauvais goût et leur copinage galopant. Les prix littéraires en sont un parfait exemple, qui plus est, et bien plus détestable que le simple fait de publier de pâles plumes sans saveur et sans poids. Les distinguer, les congratuler publiquement, est une mascarade autrement plus désobligeante envers le lecteur lambda.
Il faudrait parler de plus des profils de ces acteurs de la chaîne du livre. Où sont les véritables érudits, les véritables filtres ? Ils enseignent, au pire ou au mieux, et tu ne le sais que trop bien. Ils ne pensent pas une seconde qu’au lieu d’écrire un millionième roman faible ou essai rabâché, ils pourraient venir se salir les mains à trier ceux de ces prétendus petits auteurs incompris et inconnus qui déferlent depuis qu’on leur a dit qu’ils avaient plus de substances que les gros vendeurs, ce qui reste à mon strict avis à démontrer plus fermement que par une note sur un blog. Qu’ils viennent les corriger, les fabriquer, les vendre. Comme leurs idéaux en prendraient un coup, alors qu’ils seraient pourtant bienvenus !
Un petit éditeur n’a pas plus de mérite qu’un grand. Au même titre qu’un pauvre n’est pas plus vertueux qu’un riche. Il développe même souvent un esprit revanchard qui n’aide pas l’intelligence générale. Etre un éditeur de gauche, de plus, ne donne en rien une caution sur la qualité des textes publiés. Un nombre incalculable de génies sont de droite, et si c’est un scandale, alors il faudrait peut-être arrêter de se prétendre lecteur, car vraiment, il est absolument ridicule de se définir culturellement et intelligiblement façonné d’un même bloc, et bien malin celui qui me dira quel bord est le bon.
Je rappelle le fonds hallucinant que possède Gallimard, et les parutions audacieuses et pointues qu’il propose dans des collections comme l’Imaginaire, et ce, malgré les prises d’otages auxquelles cette maison participe en tardant à publier ou republier les œuvres dont ils achètent les droits à tour de bras pour les entasser dans leurs caves. Cher Gallimard si vous m’entendez, T.S. Eliot, par exemple, c’est quand vous voulez. Je ne citerai pas le nom de quelques maisons dites petites qui ne travaillent qu’avec des stagiaires tenus de chercher partout tous les textes gratuits disponibles pour enrichir à moindre frais leur catalogue, et là encore, nous aurions beau jeu de les en blâmer.
En vérité, grâce à ces pratiques toutes aussi douteuses les unes que les autres, les conséquences sont heureuses pour le lecteur : il peut trouver, en cherchant un peu, tout ce qu’il veut lire. Plus catastrophiques pour l’acteur de la chaîne du livre : il a trop de références à correctement gérer. Nous publions trop, mais tous autant que nous sommes. Et les Français, immodestes et aveugles, devraient lire plus et écrire moins d’inutiles ouvrages qui encombrent l’accès aux précieux. Un peu d’autodiscipline, de part et d’autres, serait bienvenue.
PRESCRIPTION
Et alors nous voici devant le problème du tri.
Je ne m’attarderai pas sur la presse traditionnelle, que je n’ai personnellement jamais consultée pour savoir quoi lire, et tu sais comme je perçois le métier de libraire. Humainement, ce sont des voix, directes, et fiables, qui me font lire. Mais surtout, ce sont les livres eux-mêmes, qui en contiennent toujours mille autres, s’ils sont toutefois bons. Ces voix, il arrive que je les trouve sur internet oui, mais encore c’est assez rare. Puisqu’il est appréciable de s’interroger sur nos diverses pratiques, je me demande exactement pourquoi cette volonté de vouloir pousser en avant des auteurs qui ne le sont pas ? Au contraire, moi je ne veux pas que tout le monde lise ce que je lis. Quelle horreur ! Je veux jalousement me les garder, oui ! Je me fous bien, libraire, de vendre les auteurs que j’aime, oui tu m’as bien lue. Je conçois mon professionnalisme comme de donner au lecteur ce qu’il veut lire, après interrogatoire en règle, pas de l’éduquer, le contraindre à mes choix ô combien subjectifs. S’il me demande mon avis je lui donne, en lui précisant ma personnalité, car il est bien sûr que s’il en est à l’opposé, il n’aimera donc pas mes lectures.
Ces fameux blogs prescripteurs, de même, me font doucement rire, surtout lorsqu’ils affichent une pseudo neutralité. Mais après tout c’est peut-être la réalité, les lecteurs majoritaires sont peut-être tout bonnement neutres, bien que je ne le croie nullement. Un bon blog littéraire, alors, c’est quoi ? Toi tu dis que tu n’aimes pas les blogs de lectures, mais de critiques. Je te réponds que je serais bien en peine de faire la distinction. Et je t’avoue que ma seule distinction, à moi, se situe, blog ou presse traditionnelle, entre la critique et la réclame.
Ils ont ensuite le bon ou le mauvais ton.
Il existe des tons, des personnalités, des voix de lecteurs, et c’est à mon sens ce qui est primordial. Disséquer avec brio, d’accord, mais seulement si l’on comprend rapidement dans quel but cela est fait, et si nous allons rapidement adhérer. Si je me sens sombre, rageuse, avec l’envie d’en découdre, je vais prêter attention aux lectures de celui qui écrit dans ces humeurs. Si j’ai envie de rire, et de trouver un esprit libre et impertinent, je sais où cliquer. Si j’ai besoin d’une dose de pittoresque, d’atypique, tu sais où je vais aller. Mais la plupart du temps, ce n’est pas véritablement pour savoir quoi acheter ou lire. C’est pour le plaisir de lire la prose de celui ou celle qui compose autour de l’ouvrage d’un autre. Prendre des cours de style, ou encore, attention gros mot, me divertir justement, puisque la Toile n’offre pas grand-chose de meilleur que cela.
Mais elle l’offre, c’est un fait, et permet l’émergence de personnalités semblables et rassurantes, ou dissemblables et intéressantes. Seulement le miracle n’est pas au tournant de chaque clic, et il est aussi rare que de trouver un bon livre dans cent mille. Et si la profusion de blogs peut sembler détestable, elle l’est bien moins à mes yeux que la possibilité d’entrer en interaction systématique avec chacun. Cette foire des possibles, au risque de me répéter, est inféconde, et terreau de tous les désespoirs, névroses et schizophrénies que nos bons psychiatres essayent parallèlement d’enrayer. Un monde malade ne me dérange pas, et reflète après tout ce que je pense fondamentalement de chaque être humain. Mais un monde malade dont on doit sans cesse entendre toutes les voix précipite largement sa fin, et j’aimerais autant que cette hystérie évite de se répandre dans mon salon à moi.

TENIR UN BLOG
Et alors je termine sur cette pratique délicate et malade qui consiste à avoir la prétention, la vanité de tenir un blog.
Moi-même lorsque je mets un livre en avant ici-bas, je me fous bien qu’on l’achète ou le lise, je veux qu’on me lise, moi, et que cela soit une lecture enrichissante pour quelqu’un qui se reconnaîtrait dans mes humeurs, ou aurait la curiosité de savoir quelles elles sont. J’entends retrouver la pureté de lire qui est celle de tisser son monde autour du livre qui nous parle, qu’il soit best-seller ou non. Je veux témoigner d’une expérience parfois mystique, cette expérience qui est la seule définition du plaisir de lire que je puisse trouver, de se mouvoir dans les limbes d’un autre, abolissant le temps et l’espace avec un peu plus de classe que ne le propose la Toile, d’avoir cette violente confrontation avec des mots qui parfois, miraculeusement, éclairent en quelques pages les obscurs pressentiments préhistoriques de nos consciences fragiles de nous-mêmes et des autres. Lire les bons, et tenter de les retenir en écrivant autour d’eux ses propres mots pour achever de les tisser très fort à notre monde et qu’ils n’en partent plus, aide cette compréhension de soi et des autres, pour la finalité que je me fais de me cultiver : vivre toujours mieux avec les autres, ceux qui sont proches, mais sans autre souci de communauté que de passer correctement les quelques heures que nous avons à passer ensemble. Pour les autres, je préfère les passer seule qu’avec de pénibles interlocuteurs.
D’ailleurs quand je dis « je veux qu’on me lise » je ne suis pas exacte. Je veux que ceux qui me connaissent me lisent, car je leur dis par ce biais toutes les choses que je ne sais pas leur dire autrement, étant bien mauvaise à l’oral, car m’emportant trop vite, et concluant trop rapidement. S’il existe sur mon blog des lecteurs inconnus, j’imagine que certains textes les aident à y voir clair dans leurs propres systèmes, je ne saurais pas comprendre autrement qu’ils le fassent. Mais si je vois, statistiquement, que des anonymes déferlent sur ce blog, je n’ai aucune illusion sur le fait qu’ils me lisent peu, et n’y restent pas, et c’est bien normal, ce n’est pas toujours à eux que je m’adresse, et jamais dans une volonté systématique de plaire à la majorité.
Je voudrais répondre à ce que tu dis de la légitimité que t’ont donné certains acteurs médiatiques tels Ariel Wizman. Cette célébrité relative me fait penser, comme je te l’ai écrit, au « Et maintenant ? » de la fin de La confrérie des mutilés d’Evenson. C’est une célébrité vaine, de communauté réduite, et je le dis sans volonté d’être désagréable parce que si je pensais que certains puissent mériter d’être « célèbres », tu ferais peut-être partie de la liste, mais je ne le pense pas. Etre reconnu tranquillement par tes pairs, me semble autrement plus honorable. Avoir du succès pourrait te donner une meilleure confiance en toi car tu en manques, comme tu l’avoues et c’est bien dommage pour toi. Et encore…
Tu dis avoir espéré, en commençant ton blog, être sollicité. Tu l’as été. Et maintenant, Bartleby, les choses changent-elles, en dehors de plus de bruit, de plus de clameurs toujours inutiles, qui te volent et ton temps et ton calme ?
Si je publie, moi, sur un blog, c’est que j’ai cherché de nombreux moyens d’expressions et n’en ai pas trouvé de meilleurs. J’aime écrire, suis contente d’être parfois lue, cela semble bien maigre mais est amplement suffisant. Des gens comme toi m’encouragent, et je ne dis pas qu’à cette occasion, je constate que certains anonymes, en se présentant, peuvent devenir de riches interlocuteurs. Le danger serait de considérer que chaque internaute qui vient flatter ton égo en t’assurant qu’il t’aime est un interlocuteur digne et enrichissant.
Et qu’il fait de toi un grand auteur, digne de rejoindre les piles de papier des libraires et lecteurs apoplectiques.
Cher Bartleby, je frôle la rupture d’anévrisme en concluant enfin ce texte tentaculaire et insensé, et je te remercie si, à ce stade, tu ne t’es pas endormi ou englué dans mes phrases pesantes.
Pour achever le tableau, tu me demandais quand j’aurais terminé d’écrire sur Le dégoût d’Horacio Castellanos Moya, que tu me fis lire. Je crois que je viens de le faire.
_______

/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)
































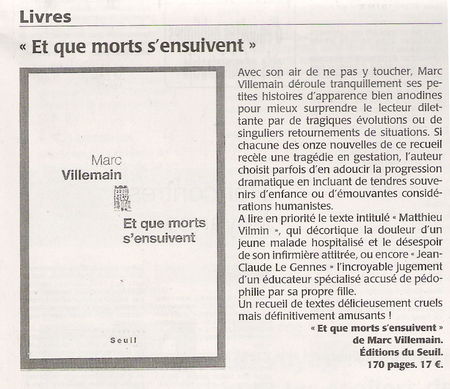
/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)