Le Magazine des Livres n° 6, septembre/octobre 2007
____________________________________________
L'échange qui suit, entre Pierre Jourde et moi-même, a paru dans Le Magazine des Livres (n° 6) de septembre/octobre 2007. Pour en faciliter la compréhension, j'en rappelle ci-dessous le contexte :
* L’affaire de Lussaud *
En 2003, Pierre Jourde publie Pays Perdu, aux éditions L’esprit des Péninsules, qui reçut cette même année le prix Génération. Le roman est l’élégie d’un monde rural qui s’éteint peu à peu, monde rugueux, secret, mesquin parfois, authentique toujours. Ses dieux y ont pour noms « Alcool, Hiver, Merde, Solitude. » L’auteur, qui s’est inspiré du village de Lussaud, dans le nord du Cantal, où sa famille possède une maison et où il se rend régulièrement, donne à voir une peinture âpre, austère mais empathique. D’une certaine manière, c’est le livre d’un deuil, celui d’une paysannerie qui vit ses derniers instants.
Deux ans après la parution de ce livre, Pierre Jourde, lors d’un séjour à Lussaud, est agressé à coups de pierres et de poings par cinq habitants du hameau, qui disent s’être reconnus dans certains portraits. Pierre Jourde se défend et blesse certains de ses agresseurs, qui eux-mêmes s’en prennent à son épouse et à ses enfants, proférant au passage des insultes racistes. L’écrivain et sa famille parviennent finalement à démarrer leur voiture et à s’enfuir. Ils portent plainte pour « coups et blessures en réunion » et « injures ». Le 21 juin 2007, le procureur Virginie Dufayet requiert six mois de prison avec sursis et 300 euros d’amende contre les prévenus. Le 5 juillet, le tribunal d’Aurillac rend son jugement, condamnant Paul Anglade, 72 ans et le plus âgé des prévenus, à 500 euros d’amende, et les autres prévenus à deux mois de prison avec sursis. Tous, à l’exception de Paul Anglade, devront en outre verser 600 euros de dommages et intérêts à Pierre Jourde, et 1 000 autres euros à chacun des trois enfants.
A l’issue du procès, Me Gilles-Jean Portejoie, avocat des prévenus, se réjouit d’une « décision d’apaisement. » Cette déclaration surprend Pierre Jourde, qui déplore que « ce jugement [soit] très indulgent par rapport aux faits », avant de déclarer : « On peut lancer des pierres à des enfants et les traiter de bougnoules et s’en tirer avec deux mois avec sursis, c’est pas cher ! ». L’une des prévenus, âgée de 61 ans, affirme « qu’on se considère comme victimes », déplorant que Pierre Jourde ait « faire revivre toutes les horreurs sur ma famille, mon gendre, ma soeur et mes parents. »
***
Cet échange débute donc avec mon propre texte, Pierre Jourde à Lussaud : écrivain ou justiciable ?, auquel Pierre Jourde répond dans un article intitulé Littérature contre journalisme. Enfin, à la toute dernière minute, et en raison de la tonalité du texte de Pierre Jourde, Joseph Vebret, directeur du Magazine des Livres, me permit de répondre très brièvement à la réponse...
Pierre Jourde à Lussaud : écrivain ou justiciable ? - Par Marc Villemain
Paul Bourget écrivait, dans ses Essais de psychologie contemporaine : « Un témoin n'est pas un miroir impassible, il est un regard qui s'émeut, et l'expression même de ce regard fait partie de ce témoignage » ; aussi attendait-il de l’écrivain qu’il se conformât « à la marche même de la vie. » Le rapprochement, peut-être malicieux, qui conduit de Paul Bourget, étendard de la bourgeoisie s’il en est, à Pierre Jourde, qui naguère se désigna lui-même comme « tonton flingueur » de la littérature, ne surprendra que ceux qui font du positionnement sur l’échiquier idéologique une valeur ontologique cardinale. Car si la citation de Paul Bourget tombe à point nommé pour étayer ce qui fut sans doute l’authentique ambition de Pierre Jourde lorsqu’il écrivit Pays perdu, il se pourrait qu’un autre trait les unisse, fût-ce à leur insu. En effet, le désir de contribuer à la moralisation du système, et des comportements individuels dans le système, participe de l’ambition littéraire commune aux deux écrivains. En des temps et pour des motifs divers, aucun ne rechigne à l’usage d’une littérature, à tout le moins d’un rapport à l’écriture, dont la visée serait aussi d’édifier. Chez l’un, la mission prit les atours du traditionalisme, chez l’autre, il prend ceux de l’irrévérence. Laquelle irrévérence se heurtait jusqu’à présent aux fleurets mouchetés du microcosme littéraire, impitoyable sans doute mais parfaitement rôdé à intégrer la chamaillerie dans son fonctionnement ; or voici que Pierre Jourde, fine lame lui-même, rencontre ici une résistance d’un tout autre calibre : celle de ses personnages.
Avant d’aller plus loin, et afin de lever toute équivoque, il me faut préciser qu’existe un contentieux, fort insignifiant, entre Pierre Jourde, Eric Naulleau, et moi-même. En effet, les deux auteurs profitèrent jadis d'un portrait au vitriol (forcément) très convenu de « BHL » pour me lancer quelques piques caustiques et comiques, m'érigeant en « maître du genre hagiographique » et me comparant à une sorte de Pascal Obispo de la littérature – il est vrai que je m’étais rendu coupable d’impudence en écrivant sur Bernard-Henri Lévy un livre qui ne pratiquât pas l’éreintement (une rareté, à ce jour) et où, plus impardonnable encore, j’avais laissé remonter à la surface des pages quelque écho d’une admiration adolescente. Toujours est-il que l’appréciation de Jourde et Naulleau me réjouit plutôt, flatté que je pouvais être, après tout, de me voir ainsi intronisé comme « maître » d’un genre, distinction qui n’est pas donnée à tout le monde. Afin de parfaire leur appréciation, j’envoyai toutefois une petite tribune amusée aux rédactions parisiennes – laquelle ne fut jamais publiée, comme de bien entendu. De tout cela il faut s’empresser de sourire et, quoique je pense par ailleurs des donneurs de leçons et de l’air du temps un tantinet flicard, il va de soi que je ne cultive à leur endroit ni rancoeur, ni animosité : le propre de l’homme est de rire des autres, et je suis plutôt bon public – quitte à être visé. Les polémiques font partie de l’histoire de France (et les polémiques littéraires adoreraient y avoir leur part), et si peux me plaindre in petto de leur nuisible inertie, il peut m’arriver de penser qu’elles aussi font le suc et le charme de notre nation. D'autant que Jourde et Naulleau occupent dans le paysage une place qui n'est pas vaine, qu'ils ont comme tout un chacun quelques raisons suffisantes de guerroyer contre le système, et surtout qu’ils peuvent s’avérer fins stylistes – Jourde surtout.
*
Si j’ai choisi d’emprunter les chemins de traverse de la morale et des mœurs éditoriales avant de rejoindre le village de Lussaud, c’est que cet aspect extralittéraire, s’il est constitutif du positionnement de Pierre Jourde dans le paysage, pourrait aussi expliquer une petite part des mésaventures qu’il y connaît. Nul n’a jamais mis en cause la justesse et l'authentique beauté de Pays perdu, que son auteur évoque comme une « description émue, tragique, souriante » de ce hameau du Cantal où son père est enterré. Le livre vient de loin, il s'imposait dans la biblio-biographie de Pierre Jourde, et personne ne doute, nonobstant sa rugosité et son âpreté légendaires, de l’amour très sincère qu’il porte à ce village dont il croqua sans complaisance la poignée d’habitants. Lesquels goûtèrent donc assez peu l'hommage qui leur fut ici rendu, et tentèrent de faire à son auteur une tête au carré qui faillit mal tourner. Ne soyons pas bégueules : que cela lui arrive à lui, le castagneur émérite, peut ne pas surprendre davantage : on ne castagne pas sans chatouiller l'écho frappeur. Mais dire cela ne saurait être entendu
comme une manière sournoise d'excuser la réaction des habitants de Lussaud : si l’on peut comprendre l’histoire, la détermination, la trajectoire, les mobiles et les motifs de leur aigreur, rien ne peut excuser leur geste, que Jourde a de bonnes raisons de considérer comme une tentative de « lynchage ». Je tiens cela pour acquis, comme je tiens pour acquis qu’un auteur doit pouvoir écrire ce que bon lui chante à propos de tout et de tous. Toutefois, pour évoquer un maître que Pierre Jourde et moi-même avons en partage, et qui de surcroît poursuit dans le Limousin une ambition littéraire qui n’est, dans l’esprit, pas très éloignée de Pays perdu, on imagine assez mal un écrivain comme Richard Millet rencontrer telle infortune, lui dont le chant d'amour pour cette terre n’attisera sans doute jamais un aussi violent courroux. On me répondra peut-être que le Limousin n’est pas l’Auvergne – ce qui reste tout de même sujet à caution. De manière plus fondamentale, la différence tient peut-être davantage à un tempérament, à la tendresse qui, dans les livres de Millet, submerge toujours ce que son regard pourrait avoir de rêche ou de féroce, mais aussi à une vision de soi, et de soi dans la littérature.
La réaction des habitants de Lussaud, qui ont su, sans doute à bon droit, se reconnaître dans les personnages de Jourde, illustre une nouvelle fois les limites d’une évolution qui, au fil du temps, a défiguré l’aspiration démocratique en un double mouvement paradoxal de sommation à la transparence et d’exacerbation des susceptibilités individuelles ; nul ne peut plus nier que cette évolution charrie une société de suspicion dont la liberté ne sort pas gagnante. Tout écrivain se confronte à la langue de bois, au politiquement correct, à l’intégrationnisme ambiant et au respect quasi constitutionnel des susceptibilités identitaires, toutes choses qui constituent notre décor contemporain. A cette aune, Pierre Jourde n’a fait que son travail d’écrivain, qui consiste à se saisir de sa liberté d’écrire – ce qui implique de tout écrire : on écrit pour tout écrire, ou on n’écrit pas. Néanmoins, tout romancier peut se demander si telle ou telle remarque, tel ou tel trait, tel ou tel mot, ne se révéleront pas trop blessants lorsque ceux qu’il pourrait aimer les liront. L'injonction à se débarrasser d'une telle prévention est tout à fait théorique, et je défie quiconque d'écrire avec l’innocence du catéchumène confessé un roman où les personnages, des parents par exemple, seraient dépeints comme des brutes ignares et avinées, sans craindre que ses propres géniteurs ne le prennent pour eux. Aussi ne dut-il pas être toujours agréable d'être membre de la famille de François Mauriac, lui qui dut puiser largement dans sa généalogie pour donner de la société familiale une représentation impitoyable de justesse et de vérité. Par éthique littéraire ou nécessité, Pierre Jourde s’est refusé à la complaisance envers des êtres et un village qu'il aime authentiquement : il est allé au bout de son écriture sans autre considération ni justification qu’elle-même. Or si cela seul importe, et vaut qu’il soit ici défendu, la chose peut évidemment avoir quelques résonances fâcheuses pour certains lecteurs : personne n'est contraint d'entrer dans les raisons d'un romancier, le roman permettant de faire ou de défaire des mondes où nul autre que son auteur n'a jamais demandé à pénétrer.
Il faut cependant mettre un terme au très fallacieux débat sur la disjonction entre réel et fiction : une fiction est toujours plus ou moins une extension du réel – quand elle n’en est pas la vérité cachée. Et même si le désenchantement de notre époque l’incline au fait divers et qu’un nombre croissant de romanciers cherchent à y renouveler leur inspiration, il faut redire qu’il n’est pas de roman qui ne s’inscrive, même d’infiniment loin, dans le monde qui se présente au regard de leur auteur. On peut déplorer ce que fit Marguerite Duras de l’affaire (sublimée) du petit Grégory, on peut interroger l’empressement de tel ou tel auteur à se saisir de drames en cours d’instruction judiciaire, mais nul ne reprochera à Balzac de s’être échiné sur les mœurs son temps, ou à Stendhal de s’être lancé dans l’écriture du Rouge et le Noir en découvrant l’affaire Antoine Berthet dans La Gazette des Tribunaux. A ce titre, Pierre-Olivier Sur, avocat médiatique et romancier à ses heures, fait preuve d’une certaine imprécision lorsque, évoquant le différend entre Pierre Jourde et les habitants de Lussaud, il considère que si l’auteur peut à bon droit emprunter le vécu d’anonymes, il « ne doit pas entrer dans le fin fond de l’intimité » – nous faisant grâce, et comme on le comprend, d’une définition juridique du fin fond de l’intimité.
Le jugement rendu le 5 juillet dernier n’est au fond satisfaisant pour personne, puisque nul n’a jamais réussi à entrer dans les raisons de l’autre. Le traumatisme vécu par Pierre Jourde, et plus spécialement par ses enfants, n’a suscité aucune espère d’émotion chez les habitants condamnés, qui continuent de se sentir insultés par le roman et victimes de l’iniquité du jugement – si tant est qu’ils reconnaissent les faits. Quant à Pierre Jourde, il n’est pas parvenu à leur faire entendre ce que ses mots d’écrivain et d’enfant du pays contenaient de tragique, de sensible et d’empathique. Jusqu’au bout, donc, avec ou sans procès, l’incompréhension aura triomphé. Mais nous touchons là aux limites de toute procédure judiciaire, dont il est courant que les acteurs en attendent toujours trop.
Le jugement a donc déplu aux deux parties. Mais quoique ait pu en penser Pierre Jourde sur le coup, il établit une culpabilité, ce qui était bien la seule chose qu’il pouvait en attendre. Aussi serait-il intéressant de connaître l'idée qu’il se fait d’une procédure pénale qui lui eût semblé juste, de savoir quelle décision de justice l’eût agréé, et avec quelles conséquences : un peu plus de prison ? un peu de moins de sursis ? d’avantage de dommages et intérêts ? J’entends qu’aucune victime devenue partie civile ne se satisfait jamais de la seule reconnaissance de culpabilité. Mais nous entrons là sur un tout autre terrain, celui de la perception que la victime a d’elle-même et de l’acuité de son sentiment victimaire, auquel elle associe de façon plus ou moins machinale un certain niveau de compensation. Or ce niveau est extrêmement mouvant au fil des époques, sa définition relevant aussi bien d’un climat judiciaire que d’un contexte global, politique, anthropologique ou civilisationnel. Il se trouve que ce tropisme victimaire n’est pas rare chez Pierre Jourde, qui trouve souvent à se plaindre des puissances en réseaux et des multiples tyrannies des pouvoirs connivents et institués. Il ne s’agit pas ici de discuter à Pierre Jourde le sentiment d’injustice qu’il peut éprouver à l’issue du jugement : lui seul sait ce qu’il a enduré, lui seul peut savoir ce qu’il attendait de réparations judiciaires. Le statut de victime, très valorisé sous Ségolène et Nicolas, est chez Pierre Jourde, peut-être pas une constante, mais au moins un trait saillant de sa personnalité. Il faut savoir ne pas le railler, ce qui serait improductif et surtout injurieux, et accepter d’y voir la part d’indicible que recèle toute souffrance intime. La procédure qu’il a engagée (et remportée), incontestable en soi, aurait toutefois gagné en clarté et en popularité s’il avait dit et justifié ce qu’il attendait du jugement, et si, par ailleurs, il n’avait pas sitôt entonné son couplet déjà classique contre les journalistes, accusés de « victimiser les coupables ». Car si quelques-uns se sont complus dans une opposition un peu méprisante entre le distingué lettré et les rustres paysans, aucun n’a cherché à lui nuire, et tous se sont émus d’un fait qui, parce que nous sommes en France et qu’un écrivain y était mêlé, n’avait plus grand-chose de « divers ». Il n’en demeure pas moins qu’une ambiguïté parasite l’appréciation que l’on peut faire de ce procès, et il n’est pas impossible qu’elle ait gêné le tribunal lui-même : Pierre Jourde luttait-il pour la liberté d’écrire, ou pour établir des dommages ? Quel Jourde s’est pourvu en justice : l’écrivain, ou le justiciable ?
***
Comme il en avait été convenu, cet article a été adressé à Pierre Jourde, qui y a répondu dans le même numéro du Magazine des Livres. Voici son texte.
Littérature contre journalisme - Par Pierre Jourde
Marc Villemain le rappelle, il a été la cible du Jourde et Naulleau. Il ne nous en tient pas rigueur, et il faut lui en savoir gré. Le texte, bienveillant, qu’il consacre à ce que l’on appellera l’affaire de Lussaud pose des problèmes intéressants. On regrette d’autant plus certaines approximations. Ainsi, brocarder un écrivain très puissant et très influent, ce serait être un « flicard ». La satire est assimilable à une opération de police. Mais lorsque l’écrivain puissant use discrètement de ses relations pour faire interdire tel article impertinent, là, ce n’est pas de la basse police, bien sûr. Passons. Passons également sur Bourget, dont les accablantes platitudes pourraient convenir à peu près à n’importe qui. Passons sur les petites inexactitudes : ce ne sont ni tous les personnages, ni tous les habitants de Lussaud qui ont mal réagi à Pays perdu, loin de là. La plupart des agresseurs ont d’ailleurs reconnu n’avoir pas lu le livre, lequel comporte beaucoup plus de tendresse que de duretés. Passons sur le fait qu’une quatrième de couverture n’est pas forcément rédigée par l’auteur, qui ne se désigne donc pas lui-même comme « tonton flingueur ».
Venons-en aux points essentiels, et d’abord la question de la morale. Je ne vise nullement à édifier ni à moraliser quoi que ce soit. Je me suis contenté, dans certains textes, de me moquer, soit de styles patauds ou grandiloquents, soit de l’écart comique entre une affectation de déontologie et de sérieux et des flagorneries poussées au grotesque. Je crois à une éthique littéraire, en effet, mais certainement pas à une illusoire et dangereuse pureté des mœurs. On sait que la république des lettres est une république bananière. Mais ce sont ses notables y tiennent le discours de la vertu, et il y a là de quoi s’amuser. L’analyse de Marc Villemain repose en grande partie sur l’idée selon laquelle j’adopterais une posture « victimaire ». L’attitude de victime serait, dans mon cas, un « trait saillant de la personnalité. » Marc Villemain y ajoute un vague pathos sur l’ « indicible » de la « souffrance intime. » Sa pénétration psychologique est ici d’autant plus remarquable que je ne me souviens pas de l’avoir jamais rencontré. Il faut donc supposer que Marc Villemain est spécialiste de la psychologie sur textes. Cette discipline, assez proche de la psychologie de comptoir, est devenue très répandue chez les journalistes. La littérature n’est plus présentée que comme le produit d’états d’âmes et de traits de personnalité. Reste que la psychologie de comptoir exige tout de même un minimum de cohérence : un « tonton flingueur » peut-il aussi avoir une personnalité de victime ? Lino Ventura cachait-il, au fond de lui, une âme de pauvre chien battu ? Mystères de la psychologie de comptoir… D’ailleurs, à ce compte, une femme qui porte plainte pour viol, un journaliste qui dénonce un cas de censure peuvent, eux aussi, se voir répondre : « est-ce que vous n’auriez pas une mentalité de victime ? ». Bref, la protestation, le combat ou l’ironie, c’est tout de même un peu pathologique. Marc Villemain emploie l’expression « se plaindre de », devenue un cliché pour désigner tout ce qui est de l’ordre de la satire ou du pamphlet. Elle permet utilement de faire passer la critique pour une sorte de complainte à usage personnel, et donc d’en réduire la portée. On ne voit pas bien le rapport entre des moqueries adressées à Angot ou Sollers, des piques à l’adresse de l’avocat de Josyane Savigneau, des quolibets envers Edwy Plenel, et le gémissement pathétique qu’adresse la malheureuse victime à son bourreau. Lorsqu’on s’attaque au Monde, aux prix littéraires, à Lévy, à Sollers et qu’on est aussi écrivain, il est préférable de n’avoir pas un tempérament de victime. On aurait, sinon, quelque difficulté à survivre. S'agirait-il alors d’une posture victimaire face aux réactions engendrées par les textes ? Je rappellerai alors que je ne me suis jamais plaint de ces réactions. Je n’ai pas cessé au contraire de déclarer que, primo, je considérais comme normal qu’une satire suscite des réactions vives et fasse elle-même l’objet d’attaques, dès l’instant qu’elles étaient ouvertes, que, secondo, la grande majorité des articles consacrés à mes livres leur était favorable, et enfin que, tertio, ma carrière de romancier n’avait pas eu à souffrir, bien au contraire, de mon activité de satiriste. Je ne me plains donc de rien, et ma personnalité victimaire n’est, je le crains, qu’une construction de l’imaginaire de Marc Villemain, qui a tendance à confondre humour et déploration élégiaque.
En revanche, j’ai en effet eu à constater qu’un ouvrage de satire littéraire pouvait susciter quelques interventions discrètes destinées à faire empêcher la publication d’articles trop favorables, à faire pression sur des organisateurs de manifestations, etc. Il ne s’agit pas là de « fleurets mouchetés. » Naïvement, je ne croyais pas cela possible, avant de constater qu’il s’agissait d’une pratique banale. J’ai donc écrit, avec Éric Naulleau, Petit Déjeuner chez tyrannie, qui n’a rien d’une complainte, mais qui dénonce la bêtise et la veulerie de certains journalistes littéraires, ainsi que la banalisation des tentatives de censure. Si l’on en croit Marc Villemain, toute critique, même la plus âpre, a quelque chose du sanglot, et tout satiriste est affecté d’une personnalité de Caliméro. Je vais profiter de l’occasion pour lui livrer un scoop.
J’ai reçu, chez moi, il y a quelques mois, un journaliste du Monde qui devait me consacrer une page-portrait. Trois jours plus tard, le même journaliste m’a téléphoné, assez gêné. Des journalistes du Monde des Livres étaient intervenus pour faire supprimer cette page-portrait, qui n’a donc jamais été publiée. Je ne m’en suis pas plaint, et ne m’en plaint toujours pas. Il y a là de quoi sourire plutôt que fondre en larmes. Mais de tels petit faits sont instructifs, et il n’est pas forcément mauvais de les rendre publics. En ce qui concerne les événements de Lussaud, je n’ai pas porté plainte pour la liberté d’écrire. Je regrette d’avoir à le dire, car la chose eût été plus flamboyante et plus facile à soutenir. La réponse à la question que pose le titre de Marc Villemain est sans équivoque : Justiciable, pas écrivain. J’ai toujours été très clair sur ce point, refusé la caricature « un écrivain contre des paysans », et dit très explicitement, à plusieurs reprises, ce que j’attendais de ce procès. Il suffisait d’écouter. Il n’y a d’ambiguïté que pour ceux qui veulent en mettre.
Dans cette affaire, la liberté d’écrire n’est pas sérieusement en cause. L’écrivain a d’ailleurs un accès aux médias plus aisé que les paysans. Cette bagarre ne m’empêchera pas d’écrire quoi que ce soit. Elle aurait pu causer mort d’homme, d’un côté ou de l’autre, handicap d’enfant, mais elle n’a pas le pouvoir d’empêcher une publication. C’est l’habituel effet pervers inverse qui est vrai : si un livre est associé à un fait divers, il se vend mieux, et Pays perdu doit malheureusement une partie de son succès à la réaction absurde d’une poignée de gens. Je n’aurais d’ailleurs pas porté plainte du tout si il ne s’était agi que d’une simple bagarre de village opposant des adultes. Cela aurait été presque abusif, même si je n’ai fait que me défendre : je m’en suis tiré indemne, et les blessures graves ont affecté mes adversaires – lesquels, je le rappelle, ont tenté d’en tirer parti pour me faire condamner. De sorte que si je n’avais pas porté plainte, je risquais fort une condamnation pour coups et blessures. Eh oui, parfois les choses ne sont pas littéraires, elles sont bêtement, très bêtement concrètes. En outre, une absence de condamnation des agresseurs aurait rendu beaucoup plus difficile le retour de ma famille dans un village où elle est implantée depuis plusieurs siècles, et auquel elle est profondément attachée.
Mais il y a plus important. Lorsqu’à six personnes on lance des pierres, qu’on met en sang un enfant d’un an, qu’on traite de « sales bougnoules » des adolescents métis, il me semble que la justice est concernée. Des enfants agressés de cette façon ont besoin, pour absorber le traumatisme, que leurs agresseurs soient condamnés. Se porter partie civile, dans ce cas, ne consiste pas à adopter une quelconque posture de victime pour la galerie, mais tout simplement à exiger que justice soit rendue. Elle l’a été. On peut trouver que deux mois avec sursis, ce n’est pas très sévère. Si un groupe de hooligans avait lapidé des enfants antillais à la sortie d’un stade en les traitant de sales négros, il y a gros à parier que le tribunal aurait été plus ferme. Le paysan, on le méprise un peu, c’est un brave bougre qui ne trouve pas ses mots, mais ça reste un peu tabou, c’est du vrai, de l’authentique, ça ne peut pas être tout à fait mauvais.
En fait, peu importe la relative indulgence de la condamnation. C’est le discours journalistique qui, sur cette affaire (on aurait envie d’ajouter comme d’habitude) a fonctionné à l’approximation, au sensationnel et au cliché. Lorsque l’on est mêlé à des événements publics et que l’on voit ce qu’en font les journalistes français, on est accablé par le mépris quasi-général des faits, l’usage fantaisiste du langage, l’amour immodéré des stéréotypes. C’est moi qui ai pris l’initiative, au lendemain des événements, de donner un entretien au Nouvel Observateur. Je l’ai fait parce que je craignais que l’affaire soit considérée par la justice comme une simple altercation de village et n’aboutisse à rien, et aussi pour éviter que l’on raconte n’importe quoi. Sur ce point, j’ai échoué. Je ne me prétends pas victime des journalistes, je ne dis pas que leurs articles étaient hostiles, mais je maintiens que, dans leur majorité, ils ont, encore une fois, avec toutes les informations à leur disposition, caricaturé les faits, quand ils ne les ont pas complètement dénaturés. Parfois, cette caricature pouvait d’ailleurs être à mon avantage, comme certains articles sur La Littérature sans estomac ont été positif et caricaturaux (en présentant un provincial vengeur à l’assaut du Paris corrompu, par exemple, ce qui est à la fois favorable, faux et idiot).
Pour certains, un auteur a été lynché par ses personnages. Forcément : un intellectuel ne peut que se faire massacrer par de solides paysans. Favorable, mais faux, c’est plutôt le contraire qui s’est produit. Mais le cliché a ses exigences, qui sont plus fortes que les faits. Pour d’autres, Paul Anglade s’est trouvé mêlé à la bagarre. Tous les témoignages, dont ceux de certains de ses complices, attestent qu’il l’a volontairement déclenchée. Mais le patriarche (joie des expressions toutes faites…) ne peut être qu’un brave homme, au fond. Aucun article ne relate les déclarations contradictoires et confuses des prévenus, leurs mensonges, leur refus de regretter les blessures faites aux enfants, leur tentative de m’accuser d’avoir attaqué avec une arme. Tout ce qui reste de ces mensonges, c’est que les pauvres gens n’ont pas les mots. C’est là une forme de mépris envers mes adversaires, que je ne partage pas. Ils sont intelligents, et savent très bien faire le pauvre paysan. Le journaliste n’attend que ça, tout heureux de prendre la comédie pour la réalité. C’est aussi reprendre la ligne de défense de Paul Anglade, qui laisse entendre, pour couvrir ses mensonges, qu’il ne sait pas s’exprimer, alors qu’un écrivain sait mettre la justice de son côté. Pourtant, ce sont les témoignages de paysans comme la doyenne du village qui ont permis d’établir la culpabilité des agresseurs. Je n’irai pas plus loin dans la liste des approximations, elle serait trop longue.
Il ne s’agit pas non plus d’écarter totalement la dimension littéraire, même si, encore une fois, elle n’est aucunement à l’origine du procès. La question de la possibilité d’écrire certaines choses, aujourd’hui, reste posée. Marc Villemain fait erreur, d’ailleurs, lorsqu’il pense que Pays perdu est le seul livre à avoir suscité une colère paysanne, même si dans ce cas précis elle a dépassé les limites admissibles. Richard Millet, Marie-Hélène Lafont, Joëlle Guillais, bien d’autres, ont subi des attaques verbales, voire des menaces. Notre époque, en dépit de sa prétention à être libérée, est tout aussi conventionnelle et frileuse que les autres, selon d’autres modalités et sur des points différents. La critique, spécialement dans le domaine culturel, est sans doute plus difficile qu’elle ne l’a jamais été. Le scandale devient un moyen de défense contre elle : il permet d’en dénaturer le sens dans une caricature à sensation.
Au-delà de cette question de la critique, notre société, Marc Villemain le relève à juste titre, a développé une hypersensibilité telle qu’il devient impossible, sur telle catégorie sociale, même pas de critiquer, mais de dire quoi que ce soit qui échappe aux stéréotypes attendus. La société s’est divisée en micro-secteurs qui interdisent tout propos ne reproduisant pas l’image qu’ils entendent donner d’eux-mêmes. Car tout est dans l’image, une image propre, contrôlée, conforme à ce qu’on voudrait que les choses soient. La paysannerie ne peut plus supporter, en termes d’image, que celle, insipide et désuète, que lui renvoie la littérature de terroir. Il est impossible s’aventurer à parler librement des Bretons, des communistes, des banlieues, des musulmans, des gendarmes, des jeunes, des vieux, des rappeurs, des homosexuels, des infirmières, des cyclistes, des cruciverbistes sans susciter les réactions scandalisées d’un comité de défense. En ce sens, la littérature reste une lutte, et peut-être le dernier recours qui nous reste contre l’effacement du réel auquel se livre le tout-puissant discours journalistique. Je ne lutte pas en priorité contre l’interdiction physique d’écrire, mais contre la déformation, d’abord des choses, ensuite du sens des textes qui tentent de les appréhender. Ce qui s’est passé à Lussaud a mis en jeu des éléments très complexes, que seul un texte littéraire pourrait démêler. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la littérature justifie tout. L’éthique y est inséparable de l’esthétique. Si un roman viole l’intimité de personnes réelles par simple appétit de scandale, et par ce goût contemporain de l’exhibition qui constitue le degré zéro du réalisme, c’est à la fois une mauvaise action et un mauvais texte, parce qu’il ne produit pas d’autre sens que l’exhibition. J’ai tenté de faire en sorte que le peu que j’ai montré de la vie privée de certaines personnes soit toujours relié à une réflexion sur la possibilité de l’intimité dans une communauté paysanne, sur la place des handicapés, sur la mort, etc. Cela ne me dédouane pourtant pas entièrement, je le sais, et la représentation littéraire de vies réelles demeure une violence.
La littérature est pour moi une quête difficile, sans fin, de la réalité, au sens que Proust donnait à ce terme. Voilà pourquoi je considère mon travail d’écrivain comme de l’antijournalisme. Il ne s’agit, en aucune manière, d’« édifier ». Il s’agit, en écrivant de rendre au réel ses droits, contre ce pseudo-réel envahissant, parasite des consciences, que crée le discours journalistique, avec son langage pauvre, ses mimétismes, ses formules convenues éternellement réitérées, sa sensiblerie, sa veulerie, ses euphémismes et ses stéréotypes. La littérature a pour fonction d’informer le réel de sa force et de complexité. C’est en ce sens
que l’écrivain est responsable.
***
Enfin, quelques heures avant que le Magazine des Livres ne parte sous presse, son directeur Joseph Vebret m'a accordé la possibilité d'une réponse très brève. Il ne s'agissait pas de répondre point par point aux réflexions de Pierre Jourde, ce qui pourtant eût été facile, mais simplement de marquer ma surprise devant la tonalité fuyante, et en vérité souvent hypocrite, de sa réponse.
Pierre Jourde à Lussaud : du justiciable au super héros - Par Marc Villemain
Ainsi donc, Pierre Jourde ne sait ou ne peut prendre une main qu’on lui tend : son tropisme polémique le conduit à transformer une main tendue et « bienveillant[e] » en coup bas. C’est son registre, pas le mien. Nous ne nous sommes certes jamais rencontrés mais, plutôt que ma toute petite personne, je préfèrerais lui présenter mon fils de cinq ans, qu’impressionnent beaucoup les super-héros. Car n’en doutons plus : Pierre Jourde en est un, qui ne souffre pas, n’éprouve jamais aucun sentiment victimaire, récuse toute légitimité à celui qui le suggère, et s’offense de la sympathie qu’un illégitime tel que moi pourrait, à ce titre, lui adresser. C’est un mec qui prend des coups, et les rend.
Quant au fond de mon propos, qu’il a tout de même dû trouver suffisamment judicieux pour y consacrer cinq feuillets, il n’y répond pas (sauf par le sarcasme et le mépris), et profite de cette énième tribune pour régler ses comptes avec les journalistes – dont il sait pertinemment que je ne suis pas. Aussi, quoiqu’il revendique ici son statut de justiciable tout en se félicitant de ne pas s’être fait « massacrer par de solides paysans » (et de préciser avec élégance que « c’est plutôt le contraire qui s’est produit »), il ne peut assumer, donc écrire, ce qu’il attendait d’une décision de justice dont il continue de contester la « relative indulgence ».
Il eût été tellement plus stimulant, pour la clarté de l’échange et pour nos intelligences respectives, de saisir la main d’un auteur insoupçonnable de complaisance à son endroit. Plutôt que de corriger certains traits caricaturaux de sa marionnette médiatique, il a préféré les accentuer. Dommage, et dont acte.
***
 Jean Echenoz - Michel Déon - Leo van Maris et Norbert Cassegrain
Jean Echenoz - Michel Déon - Leo van Maris et Norbert Cassegrain
/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)





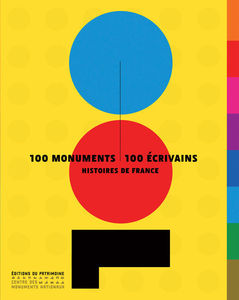










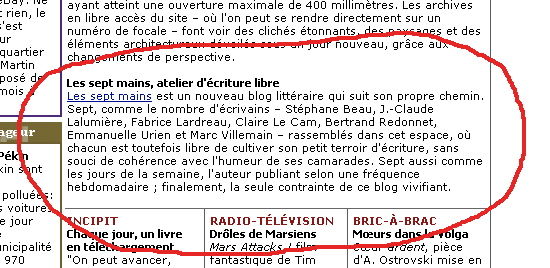


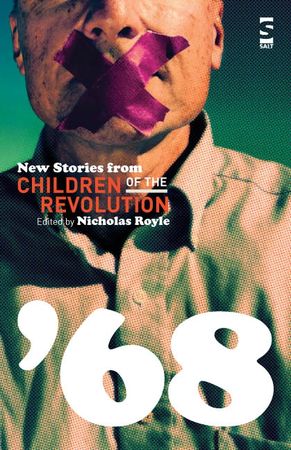
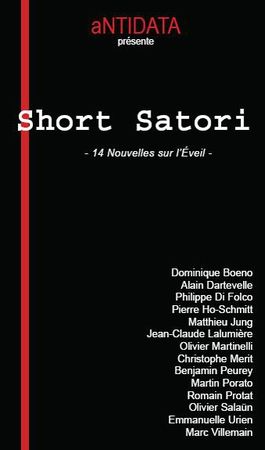



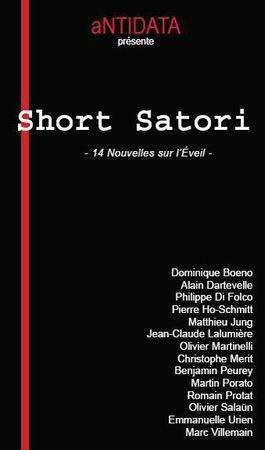
/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)