Ce jour-là
Quand il l’avait vue sauter, son sang n’avait fait qu’un tour. Parfois il y repense, se dit : c’est l’amour peut-être qui déjà était là, mais oui, c’est ça, c’était peut-être bien déjà de l’amour. Il le lui avait dit, plus tard, un jour, que ce qui l’avait conduit à sauter, ce jour-là, il pense que c’était déjà de l’amour ; et pas seulement un geste secourable, pas seulement un acte de conscience, un bon réflexe ou quelque chose comme ça. Tu comprends ? Naturellement, elle répondit ce que chacun aurait répondu : comment aurais-tu pu m’aimer alors que tu ne savais pas qui j’étais ? Et bien sûr il s’embrouillait dans ses explications. D’ailleurs il le sait bien qu’on ne peut fonder aucune certitude sur l’intime conviction, pas plus qu’il ne suffit de dire que le soleil est jaune ou que la poire est juteuse pour que l’un et l’autre le soient vraiment – aussi bien, on aurait parfois envie de dire l’inverse, que la poire est jaune et le soleil juteux, c’est bien la preuve que. N’importe, pour lui, dans sa tête, les choses étaient claires : c’est parce qu’il l’aimait déjà qu’il avait sauté. Ce qui bien sûr ne signifie pas qu’il n’aurait pas sauté pour une autre qu’elle : juste que, dans ce cas-ci, c’est pour ça qu’il avait sauté. Parce qu’il l’aimait. Et c’est ce qu’il lui dit chaque fois qu’ils se remémorent l’événement : parce que je t’aimais. Quoique entre eux ils ne disent jamais l’événement : c’est ce jour-là qu’ils disent – tu te souviens, ce jour-là ; d’ailleurs, ce jour-là ; avant ce jour-là, après ce jour-là ; etc. Jusqu’où elle va se loger, la pudeur. C’est agaçant, à la fin, d’éprouver les choses, de les éprouver avec une belle netteté, de les sentir aussi justes qu’est juste une addition bien posée, aussi vraies qu’il est vrai que cette table a quatre pieds, et de ne jamais réussir à se faire comprendre. L’immatériel est-il toujours intangible ?, aurait demandé M. Picuret, son professeur de philosophie au lycée qui maintenant – le lycée, pas le professeur de philosophie – était celui de Cécile, sa fille. Ou : Ce qui est tangible est-il nécessairement matériel ? Voilà pourquoi il s’embrouillait toujours dans ses explications : ce qu’il éprouvait ne pouvait jamais s’énoncer clairement. Ce qui n’enlevait rien au fait que ce qu’il éprouvait était vrai, puisqu’il l’éprouvait. Avec le temps, tout cela avait fini par devenir entre eux un objet de plaisanterie. Et il continuait de s’agacer lui-même, des années plus tard, de ne jamais parvenir à lui expliquer son intuition, de ne jamais réussir à la lui démontrer, et elle alors elle le taquinait. C’est que ça la faisait sourire de le voir s’énerver pour ça. Pour si peu, elle disait. Tenez, pas plus tard que ce soir, Chez Federico, ce petit restaurant italien où ils ont leurs habitudes, notamment d’y manger une Regina le vendredi soir – tous les vendredis soir, en fait, c’est-à-dire chaque fois que Cécile prend le bus pour retourner chez sa mère. Federico n’est pas le nom du patron de Chez Federico : le patron c’est Orlando, son fils. Federico, le vrai, le paternel, il est mort il y a longtemps. Enfin pas si longtemps, parce que longtemps ça veut dire quoi ? Souvent, on dit longtemps à défaut d’autre chose, parce que c’est pratique, histoire de dire que c’est fini, que ça fait un certain temps déjà. Bon, mais s’il parle de ça, c’est parce qu’elle lui pose la question, là, ce soir : au fait, Federico, c’est le patron ? Donc non, il lui répond – puis il lui explique le fils, le père, tout ça. D’où ce nouveau problème, au moment où ce mot de longtemps franchit ses lèvres, tant il lui semble incongru. Peut-être pas incongru, au moins incertain. Imprécis, disons. Longtemps, ça ne veut rien dire, longtemps ça pourrait être il y a six mois comme il y a six siècles. La sensation du longtemps, c’est aussi pénible et absurde à expliquer que cette certitude d’avoir sauté parce qu’il l’aimait déjà. Et ça, pour le coup, c’était il y a longtemps.
Vingt-et-un ans exactement. Pour une fois qu’une chose est sûre, autant ne pas se priver de la souligner. Un soir de novembre. D’ailleurs moins un soir qu’un début de soirée : c’était quand il longeait les quais, comme il le fait chaque début de soirée, retour de son travail. Il n’y a rien là de très poétique, contrairement peut-être à ce qu’une image un peu convenue pourrait laisser penser : s’il longeait les quais, c’est seulement parce que les quais, c’est le chemin le plus sûr pour, de son travail, rentrer chez lui. Mais c’est vrai qu’ils sont jolis, ces quais, qu’ils sont bien entretenus. Quoique cela ne soit pas spécialement la qualité de l’entretien qui les fasse si jolis. Ils sont jolis sans doute parce qu’ils l’ont toujours été. Et puis ils sont dans la ville sans vraiment y être, et ça il aime bien. Il aime se sentir chez lui sans y être tout à fait. Longer cette frontière entre le métal et le bois, le béton et la verdure. Mais une frontière poreuse, et c’est cela qui importe, pour lui, que les frontières soient poreuses. Qu’elles entremêlent les mondes tout en les distinguant. Ce n’était pas un no man’s land – toujours les grands mots ! –, ça non, pas un no man’s land, mais comme une vaste berge où se perdre, une sente incertaine, mi-terre, mi-bitume, où la lumière vacille un peu, s’estompe, s’arc-boute à d’autres contrastes, un peu plus terne, c’est vrai, mais étrangement plus éclatante aussi ; plus liquide il disait – c’est un peu idiot, une lumière liquide, mais c’est ça pourtant, c’est l’impression et le mot qui lui venaient. Toujours est-il que c’est le chemin qu’il prend tous les soirs depuis longtemps – pas si longtemps, enfin pas loin de trente ans quand même – pour rentrer chez lui après son travail. Il est vendeur. Même si le mot n’apparaît nulle part, pas même dans son contrat de travail : c’est attaché commercial qu’on dit, lui avait dit le patron, enfin le directeur général, le jour de son embauche. Mais les gens ils disent vendeur, et ils disent patron, et c’est vrai aussi. Il vend des voitures. À des prix qui ne battent aucune concurrence – il aime bien faire ça, renverser les propositions, surtout quand ça correspond à la vérité : les voitures qu’il vend, ce n’est pas pour lui, il veut dire pas pour les gens comme lui. D’ailleurs ce n’est pas pour grand-monde, il faut vraiment être Crésus pour s’acheter ces voitures. Elles sont tellement rares et chères que son patron n’a même jamais accepté qu’il aille en essayer une. Ne serait-ce qu’une fois, une seule fois. Pourtant ça fait longtemps qu’il est dans la maison – façon de parler, bien sûr : ça fait vingt-six ans. Le mieux qu’il ait pu faire, c’est de s’asseoir au volant d’une de ces voitures qu’on laisse toujours exposées en vitrine, moteur éteint. Ça lui arrive encore parfois de le faire, mais bien sûr il lui faut un prétexte – tout trouvé : pour être un bon vendeur, il faut bien connaître son produit. Il s’assoit devant le volant, ajuste la hauteur de l’appuie-tête, incline le siège pour que son corps l’épouse au mieux, que l’ergonomie respecte bien son dos, et ses lombaires surtout, il a toujours les lombaires un peu tendues, puis il le fait coulisser jusqu’à ce que ses jambes soient à bonne distance des pédales. Lorsqu’il juge que le dos est correctement lové dans le cuir souple et austère, il tend ses bras bien droit devant lui et pose les mains sur le volant gainé de suédine, ferme les yeux, respire à fond : l’odeur du cuir neuf lui a toujours procuré une sensation très vive, indéfinissable sans doute, en toute rigueur, mais très agréable ; presque addictive. Il roule, appuie sur le champignon, débraye, freine, passe les vitesses, il avale le goudron satiné des grandes autoroutes allemandes, derrière le pare-brise les platanes, les buissons, les herbes folles des petites routes départementales défilent et s’inclinent, et la tête lui tourne lorsqu’en se penchant il suit le tracé des corniches, avec leurs virages verglacés, leurs hauts conifères ébouriffés et leurs précipices, tout en bas, à la perpendiculaire des accotements. Dans la rue, il arrive que des gens s’arrêtent et le regardent. Il a les yeux fermés mais pourtant il le sait, il sait bien que des gens le regardent. Il sait aussi qu’ils s’esclaffent, ça arrive. Une fois, en le désignant du doigt, quelqu’un a dit : pauvre taré.
Orlando s’approche de leur table, tenant dans chaque main une coupe de ce petit blanc pétillant que produit sa famille installée du côté de Lecce, dans les Pouilles. Comment va Orlando ? lui demande-t-il alors qu’Orlando est juste devant lui et qu’il aurait suffit de dire comment allez-vous. Il entend bien que l’expression est un peu étrange, mais il l’a déjà entendue de la bouche d’autres personnes, souvent des gens très bien. En certaines circonstances, une formulation indirecte peut être préférable : comment va Orlando ?, ce n’est rien d’autre finalement qu’une manière un peu futée de faire sentir qu’on joue à mettre de la distance alors que c’est précisément en en mettant, pour peu que l’expression du visage et le maintien du corps accompagnent correctement l’intention, qu’on émet, mieux qu’un mot, un signal d’amitié. Le stratagème fonctionne d’ailleurs parfaitement, puisqu’il s’entend répondre, gratifié d’un large sourire : Orlando va très bien, merci !
Tout à fait le genre de choses qu’il aime, ça : que les hommes sachent se comprendre à mi-mots. Mais voilà. Certaines choses résistent. Et le fait est qu’il échoue depuis vingt-et-un ans à lui expliquer, à elle qu’il aime, pourquoi il sait, profondément, définitivement, qu’il a sauté ce jour-là parce qu’il l’aimait. Et ce soir encore, ce soir Chez Federico. Je ne t’avais pas vue sur la berge, au départ, enfin je n’avais pas vu que tu y étais, mais je t’ai vue quand tu as sauté. J’ai vu cette femme – toi – les deux bras tendus vers l’avant, le corps incliné vers l’avant, le pied droit levé au-dessus du vide, enfin au-dessus de l’eau, de l’eau du canal, c’était une très belle silhouette, d’ailleurs tu as toujours une silhouette magnifique, elle était très belle cette silhouette, donc, la tienne, mais très troublante aussi, parce que d’où j’étais je ne pouvais pas dire ce qui la faisait tenir, ou ce qui la retenait encore, je ne pouvais pas dire, dans le laps incertain où elle se présentait à mon regard, si elle tombait ou si elle luttait pour inverser la chute du corps en avant, si elle y allait franco ou si au contraire de son pied droit elle cherchait à retrouver le socle ferme de la terre, et c’est cette hésitation je crois que j’ai aimée, enfin pas cette hésitation parce que toi tu n’hésitais pas, toi tu voulais mourir, disons-le – ça ne t’ennuie pas, dis ? – mais moi c’est l’image de l’hésitation que j’ai vue, de l’indécision plutôt, mais bien sûr c’est mon regard qui souffrait d’indécision, je le sais bien, et alors c’est cette souffrance qui m’a fait t’aimer, du moins qui m’a fait aimer cette silhouette qui n’était pas encore toi quoiqu’elle fût déjà tienne, et cette grâce, assez inouïe quand tu y penses, la grâce d’une telle silhouette, élégante, sensuelle, permets-moi de te le dire, oui, sensuelle, et ce qui, dans cette grâce et cette sensualité, venait se loger comme émotion et comme malheur. C’est pour ça que j’ai sauté, tu comprends, pour sauver cette grâce, pour te sauver toi, parce que j’aimais déjà cette grâce, parce que je t’aimais toi, déjà.
Allora, ce petit blanc ? Il parlait, il parlait, mais Orlando était toujours debout face à eux, à attendre – non qu’il l’ait absolument oublié, remarquez, mais que, comme d’habitude, il s’était laissé aller, et bien sûr, encore une fois, il s’embrouillait dans ses explications. Alors il trempe en même temps qu’elle ses lèvres dans le verre de petit blanc. Excellent, comme toujours ! Comment dites-vous, déjà… « Come sempre » ? Il l’aimait bien, cet Orlando-là, mais il se sentait gêné d’avoir ainsi parlé devant lui, parlé de choses si personnelles, si intimes, même si, se rassurait-il, il est peu probable qu’il ait compris quoi que ce soit à ce que je racontais. Si, « come sempre », esattamente ! Orlando avait aussi bien de la sympathie pour lui, ça se voyait, ces deux-là étaient ses bons clients du vendredi. Elle bien sûr elle ne disait rien, elle souriait, elle souriait comme elle sourit toujours quand il se mettait, pour si peu, dans un tel état, quand ça le reprenait d’évoquer ce jour-là, ce jour où elle avait voulu mourir – bien sûr qu’il peut en parler, et oui il peut le dire, c’est bien mourir qu’elle avait voulu. C’était il y a longtemps, vingt-et-un ans c’est longtemps, mais quand on a voulu mourir une fois, qu’est-ce que ça devient ? Elle avait beau lui dire en souriant qu’il ne fallait jamais craindre d’évoquer ce jour-là, lui dire que tout cela était déjà bien vieux, de l’histoire ancienne, qu’elle-même alors était, d’une certaine manière, une autre que ce qu’elle est, elle sait bien, du moins le sent-elle, que, quand on a voulu mourir une fois, ça persiste toujours un peu, quelque part en soi, à la manière d’une ombre, sous une sorte de forme spectrale, de fuyante hallucination, fuyante mais obstinée tout de même, et cette impression alors que la pointe d’une lame vient lui trouer le sein. Orlando s’en est retourné dans ses cuisines, et eux ils ont continué à déguster le petit blanc de ses Pouilles, puis il est revenu, une Regina dans chaque main, ainsi qu’il leur avait porté les deux coupes. Ils ont mangé de bon cœur, sans trop échanger d’ailleurs, lui peut-être s’en voulant de n’avoir pas su faire taire ces mots en lui, d’avoir réveillé ce noyau de mélancolie autour duquel ils avaient bâti leur bonheur, elle peut-être un peu ailleurs, un peu dans ce jour-là, où malgré lui il la faisait revenir, revenir à cette époque qui paraîtrait volontiers lointaine mais qui pourtant remonte en elle comme une pierre que l’on remonte le long d’un puits, sans qu’elle sache vraiment pourquoi, sans qu’elle sente rien venir, mais ils l’ont mangée de bon cœur, ça oui, la Regina, la pâte humide et suave de sa mozarelle, son origan, son basilic, et lui il mange d’un sourire timide, et elle elle mange d’un œil un peu embué. Et ils se regardent en mangeant. Ils ne savent pas si on les regarde, parce que même s’il est calme le restaurant est plein de monde, alors peut-être, oui, après tout, les regarde-t-on, peut-être regarde-t-on ce couple si bien assorti qui se regarde en mangeant, et même pas à la dérobée d’ailleurs, qui se regarde vraiment, sans mot dire, l’un avec son sourire l’autre avec son œil, mais pour se dire la même chose au fond, le même amour inquiet.
La seule chose qui pourrait les dissuader d’aller dans un restaurant italien, c’est la gaieté des Italiens. Dans les restaurants italiens, ils se croient toujours obligés à cette gaieté, qu’on la dirait obligée à force d’exubérer. C’est pourquoi il aime venir Chez Federico, mais il devrait plutôt dire chez Orlando, puisque c’est Orlando le patron. Il aime parce que, lui, Orlando, il ne se sent pas obligé à ces salamalecs, il ne se sent pas obligé à ces guimauves de son pays qu’on entend dans les restaurants italiens de France, au point qu’on peut se demander si, avec le temps, chaque Français ne s’est pas intimement convaincu que toute chanson italienne était une guimauve, alors que l’Italie bordel de merde c’est aussi le drame et la tragédie. Il voit d’ailleurs dans le refus d’Orlando de faire entendre ces guimauves un geste d’estime, non seulement pour ses clients, mais pour la France – il est comme ça, un peu grandiloquent, parfois. Orlando, ce qu’il aime de chez lui, de l’Italie, c’est la grandeur mêlée de tristesse immémoriale, c’est la joie mêlée de deuil. Dîner d’une Regina en écoutant le Requiem de Verdi : voilà, pour Orlando, ce que doit, ce que devrait être l’Italie. C’est beau, le Requiem de Verdi, c’est beau et triste. C’est tout comme ils sont, eux, tous deux, beaux et tristes, mastiquant leur Regina, comme suspendus au temps et au chant du Requiem, un peu reclus sur eux-mêmes aussi, sur leurs souvenirs, celui de ce jour-là mais pas seulement, aussi tous ceux qui sont venus après ce jour-là – qui, peut-être, sont nés de lui. Moins des souvenirs d’ailleurs qu’un halo de souvenirs, le songe de ce qu’ils étaient, de ce qu’ils furent, et la pensée de ce réel qui les fait tels qu’ils sont aujourd’hui, alors que cette année ils s’en vont l’un l’autre passer le cap qui leur permettra de dire qu’ils ont vécu davantage d’années ensemble que l’un sans l’autre. Bientôt quarante-deux ans ? lui dit-il, une hésitation dans la voix où sourd autant de trouble que de malice. À qui le dis-tu, réplique-t-elle avec dans le timbre cette sorte de facétie d’amour qui le fait fondre, puisque donc ils sont nés la même année, même si elle un peu avant lui. Car ils sont bien jeunes encore, voilà ce dont ils conviennent en portant un toast les yeux dans les yeux, avec en bordure une petite ride rieuse malgré tout. Bien trop jeunes encore pour laisser le halo s’étendre, voilà ce qu’ils auraient envie de décider si la vie ne les incitait pas sans relâche au contraire, à tout bout de champ, peut-être parce que leur vie ensemble s’était nouée ce jour-là et que depuis ce jour-là ils s’aimaient sans jamais parvenir à défaire ce nœud qui les jeta l’un vers l’autre, sans jamais réussir à éteindre l’angoisse qui n’en finit plus de couver sous cet amour qu’engendra la rencontre d’une âme à bout de souffle et d’un cœur dans l’attente.
Elle lui a dit je reviens et elle s’est levée, et quand elle s’est levée soudain il a revu la silhouette qu’il avait vue il y a vingt-et-un ans, la même silhouette élégante et sensuelle, et qui d’ailleurs n’est élégante et sensuelle que parce qu’elle l’ignore. Il a vu aussi quelques hommes se retourner, ils voulaient en profiter eux aussi, eux aussi ils voulaient avoir leur part de bonheur, leur part de beauté, et pas seulement des hommes d’ailleurs, une ou deux femmes aussi, mais d’une manière un peu différente s’est-il dit sans vraiment savoir comment la qualifier. À peine avait-il eu le temps de se faire ces remarques que déjà la porte qui mène aux toilettes du restaurant finissait de se refermer sur elle, comme dans un ralenti de cinéma, et c’est à peine s’il avait vu sa silhouette passer la porte en tenant légèrement la poignée derrière elle, de dos, inconsciente de l’effet qu’elle produisait, sur lui, sur les autres, sans conscience aucune de sa candeur, de la beauté de ce geste si banal, de ce qu’attisait cette cambrure au bas de son dos au moment où elle tirait sa main derrière elle pour refermer la porte sans un coup d’œil pour personne, ni pour rien d’ailleurs, et de tout cela il ne savait que faire, de toute cela il ne savait que penser. Alors il resta seul. Perdu dans la petite trace rouge des lèvres sur le bord du verre de blanc pétillant. C’était un moment calme, apaisant, il n’éprouvait ni humeur ni ombrage puisqu’il savait qu’elle serait là, de retour, d’un instant à l’autre, remaquillée, il le sait, un simple éclat de mascara sur les cils, comme toujours, une légère humidité carmin sur les lèvres, comme toujours, et dans le fond de l’œil ce quelque chose d’aqueux qui ne cherche même pas à dissimuler la part vulnérable de l’âme.
Subrepticement il repense à ce jour-là, il se souvient du lieu. Il veut dire du lieu exact, et de la lumière que le jour rendait à cette heure-là, une lumière plus soyeuse que la peau du renard et plus rousse qu’une lune d’avril, et pourtant c’était novembre, et pourtant il faisait froid, mais il y avait ce lampadaire, là, sur le quai, sur la berge surélevée, et comme il n’était pas si tard l’ampoule n’était pas bien jaune encore, orangée disons, et dans le clair-obscur qui venait et s’épaississait, la lumière du monde avait cette chaleur étrange et teintée, tandis qu’au loin la ville rentrait chez elle et qu’au-dessus de leur tête un goéland déployait grand ses voilures, perdu lui aussi peut-être, cherchant à rejoindre les siens. Il repense à ce jour-là et se dit qu’ils ont vécu avec lui, vieilli avec lui, qu’ils l’ont embarqué avec eux, ce ténébreux gardien de leur amour, bien plus qu’une ombre : une présence aussi nette que le petit éclat rouge niché tout au fond du tabernacle.
Mais elle revient, elle est comme il savait qu’elle serait – le mascara, le rouge, cette eau lointaine dans l’œil, cet exil au fond de l’âme –, dieu qu’elle est belle quand elle sourit comme ça, c’est imperceptible et c’est sûr elle ne le sait pas elle-même, son tout juste bout de langue qui sourd comme celle d’un petit chat, et elle semble surprise du regard qu’il lui porte. Il ne trouve que ça à lui dire, que tu es belle. Et elle c’est une femme, une femme avec de la distinction, et de la pudeur, alors que tu es sot sera sa seule réponse, mais au fond elle ne compte pas, la réponse, comme toujours ce ne sont pas les mots qui comptent, ce qui compte c’est la manière, c’est les yeux qui tressaillent, c’est le menton qui s’incline, c’est le fard léger qui monte aux joues, c’est aussi ce tremblement dans la main, ce tremblement fragile au moment de s’appuyer sur le dossier de la chaise et de se rasseoir. Mais parce que c’est une femme elle s’inquiète, les femmes s’inquiètent toujours des compliments qu’on leur adresse, même si ce ne sont pas exactement des compliments, plutôt des impulsions, plutôt une intrusion du cœur dans le verbe, plutôt une injonction où l’on se trouve parfois à dire, à essayer de dire ce qu’on éprouve, alors en général on va puiser dans des mots très simples, tu es belle. Je t’aime. Ce qu’il n’a pas dit, là, mais il aurait pu. Il ne l’a pas dit parce qu’il n’est jamais sûr que ce soit le bon moment pour le dire, il sait, plutôt il pressent, qu’on ne choisit pas forcément ce moment mais que ce sont les conditions qui en décident, les conditions, l’atmosphère, les circonstances. Là, que tu es belle, il lui semble que c’est suffisant, en tout cas que ça lui suffit, à elle, qui déjà en semble gênée, même s’il devine que la gêne participe de son bonheur mais là encore il n’aura pas les mots pour l’expliquer. Quelques tables derrière eux une dame éclate de rire. Tous deux ils se retournent et voient combien elle est grosse, cette dame, ils voient son chemisier qui bâille sur la grosse poitrine, et la trace de crème épaisse et blanche qui commence à sécher au-dessus de sa lèvre supérieure et qui lui fait comme une moustache, mais elle finit par s’en rendre compte, sans doute parce qu’elle se sent regardée, alors elle se baisse pour ramasser sa serviette tombée en même temps qu’elle éclatait et elle s’essuie la bouche avec des allures de châtelaine. Il a eu raison de ne pas lui dire je t’aime, la grosse dame aurait tout gâché, il a eu raison les conditions n’étaient pas réunies.
Orlando remarque que c’est une soirée bien fraîche pour un mois d’avril, qu’on se croirait en plein mois de novembre. Alors il fait bien des recommandations à ses deux bons clients du vendredi, et comme à cause de son sac elle peine à endosser sa capeline, avec grande gentillesse il l’aide à l’ajuster sur ses épaules, et tous trois se serrent la main, buona sera. Et c’est vrai qu’au dehors, une fois refermée la porte de Chez Federico, c’est vrai qu’au dehors il fait un peu frais, alors dans un frisson ils se rapprochent l’un de l’autre et se prennent mutuellement le bras pour marcher le long du quai. Oui, c’est étonnant comme les saisons parfois se jouent de nous, c’est étonnant ce que le ciel peut nous réserver de surprises.
Il marche quelques pas derrière elle, d’abord il accélère un peu le pas, pour la rejoindre, pour se mettre à sa hauteur, puis non il décide que non, de rester un peu en retrait, quelques pas derrière elle, parce que c’est agréable aussi de regarder marcher la femme qu’on aime, de suivre une silhouette élégante et sensuelle dont les contours rougeoient sous la lune et l’éclairage du grand réverbère : marcher derrière la femme qu’on aime, juste de quelques pas, c’est aussi l’aimer, c’est aussi cela, on peut l’aimer en marchant à ses côtés et en lui prenant le bras mais on peut aussi l’aimer en demeurant un peu en arrière, parce qu’au fond c’est ça la vie, en tout cas c’est la sienne, il sera toujours derrière elle. Mais elle s’arrête, elle se retourne, vaguement préoccupée peut-être, préoccupée sans doute qu’il ne cherche pas à la rejoindre, à revenir à sa hauteur, et elle a dans le regard quelque chose qui n’est pas encore une perplexité mais au moins un questionnement, une sorte de petite frayeur soudaine, de manque. Quelques mètres les séparent, elle lui tend la main, et le voilà qui s’en saisit, et de nouveau ils marchent, l’un à côté de l’autre, et de nouveau il a glissé son bras sous son bras, et alors ils commencent à s’habituer à ce froid un peu sec, leur pas se fait plus lent.
Le ciel est à peu près dégagé, on y entend seulement le froufrou de quelques oiseaux, et la ville au loin renvoie ses reflets orangés, et sa rumeur qu’amortissent un peu l’espace et la nuit. Orlando sort de Chez Federico, il prend l’air quelques instants sur le pas de la porte, le temps d’une cigarette. Il la fume très tranquillement, sans aucune nervosité, et par la porte mal refermée lui parvient le chant puissant et douloureux du Lacrymosa, bientôt la fin du Requiem, il va devoir changer de disque. Quelques minutes encore, il a quelques minutes encore devant lui, alors il rejette la fumée en la soufflant vers le haut, vers le ciel où les goélands s’élancent à tire-d’aile, il trouve ça beau. Puis il baisse la tête pour écraser du pied sa cigarette au sol et remarque leurs deux ombres au loin, il reconnaît bien là leur façon de marcher l’un près de l’autre, il reconnaît bien là cette manière silencieuse de s’aimer – il en sourit. Mais déjà il n’en est plus tout à fait sûr, ce ne sont plus guère que deux petits points suspendus à la nuit d’avril, et dans la lumière du quai où la couleur éteinte du monde incertain se réverbère, on pourrait presque croire qu’ils marchent sur l’eau.
/image%2F1371200%2F20240404%2Fob_c3f3d8_image-184.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240404%2Fob_ae5cb5_image-185.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240404%2Fob_83f92d_image-186.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240404%2Fob_84a8c4_image-187.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240404%2Fob_1feed8_image-193.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240404%2Fob_ea4aca_image-195.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240404%2Fob_59c631_image-194.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240405%2Fob_90ed47_image-213.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240405%2Fob_c595b7_image-216.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240405%2Fob_3e861b_image-219.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240405%2Fob_6ad651_image-223.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240405%2Fob_6c1fd4_image-224.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240405%2Fob_08e468_image-228.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240405%2Fob_e9dfd0_image-227.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240406%2Fob_e1451f_image-238.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240406%2Fob_a694ba_image-239.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240406%2Fob_2a7455_image-247.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240407%2Fob_aa2aed_image-258.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240407%2Fob_40c03b_image-259.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240407%2Fob_6388aa_image-260.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240407%2Fob_35a6c2_image-265.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240410%2Fob_6a2a49_image-1.jpeg)





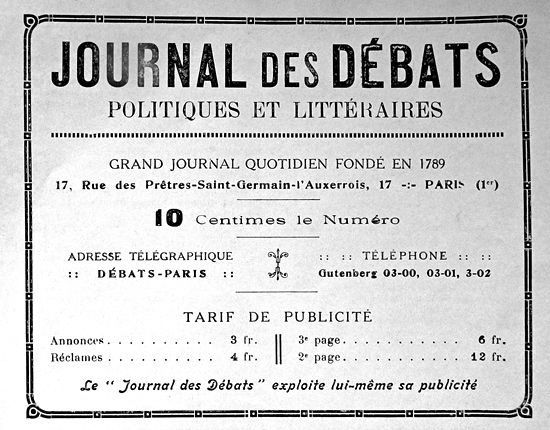

/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)