 Lorsque le noir devient couleur - Entretien avec Joseph Vebret
Lorsque le noir devient couleur - Entretien avec Joseph Vebret
Le Magazine des Livres – Numéro 15, avril/mai 2009
Une écriture au scalpel qui dissèque la noirceur, ce que l’oeil du romancier est seul capable de discerner derrière les bons sentiments. Un pessimisme, qui n’est peut-être que de façade, un recul indéniable, un cynisme qui, finalement, s’il est partagé par le lecteur, donne à rire des travers de la nature humaine.
Comment l’envie d’écrire vous est-elle venue ?
Sait-on jamais comment elle nous vient… ? De manière générale, je ne crois guère aux événements fondateurs, mais bien davantage aux trajectoires, aux très lentes impulsions, à ce que l’existence dépose en nous, sous forme d’alluvions ou de sédiments. Bien sûr, je ne peux pas ne pas considérer ce qui a constitué le monde de mon enfance : mes parents étaient professeurs de lettres classiques (quoique je n’ai pas souvenir d’une quelconque injonction parentale à la lecture), et mon grand-père, Pierre Villemain, que je n’ai pas connu, était écrivain. Peut-être m’aveuglé-je en jugeant que tout cela n’est pas absolument décisif. Ce que je crois, c’est que lorsque j’ai écrit mes premiers textes, autour de mes vingt ans, il s’agissait déjà de combler un sentiment d’incomplétude. De fouiller ce qui me faisait sentir en relative inadéquation avec le monde, de creuser mon terrier, d’apprendre à habiter ma tanière. Et, je le dis sans impudeur ni affectation aucune, de m’émanciper, de mon père d’abord, de sa mort ensuite, et ce faisant de conquérir une dimension de la vie qui fût entièrement mienne. L’écriture devenant, non seulement le seul espace, mais le seul lieu où je pouvais et où je peux continuer de me sentir entier dans la solitude.
Pourquoi avoir choisi cette forme d’écriture, la nouvelle ?
Précisément, mes tout premiers textes furent des nouvelles – jamais publiées, cela va de soi. Mais j’en garde un souvenir incroyablement euphorique. Comme si j’avais enfin réussi quelque chose, quelque chose dont je prouvais, fût-ce avec une infinie maladresse, qu’elle m’appartenait en propre. S’agissant de la forme elle-même, j’avoue ne pas savoir ce qui m’y a conduit. Je pourrais, pêle-mêle, invoquer la peur du roman, mon rapport assez spasmodique à l’écriture, un certain goût pour ce que la sensation recèle de fugitif ou de provisoire, sans parler d’une certaine indolence personnelle… Ce que je sais en revanche, c’est que l’écriture des nouvelles qui viennent de paraître fut source d’une joie infiniment plus intense, et d’une certaine manière plus vraie, que mes deux précédents livres.
L’écriture est-elle chez vous une seconde peau ? Êtes-vous constamment en éveil, prenez-vous beaucoup de notes, vous astreignez-vous à une régularité ou est-ce par à-coups ?
Une seconde peau, sûrement pas ; cela serait sans doute très romantique, mais ce n’est pas le cas. Qui n’attend pas grand-chose de la vie peux bien vivre sans écrire. En revanche, je constate qu’il n’est pas une seconde, pas un instant de l’existence, que ne travaille la perspective ou la possibilité de l’écriture, pas un moment de l’existant que je ne songe à transformer en expression écrite. C’est peut-être cela, au fond, un écrivain, quelqu’un qui n’envisage et ne reçois l’existence qu’au tamis de l’écriture. Pour ce qui est de la méthode, il m’arrive de prendre des notes, oui, mais je ne m’en sers finalement que très peu. J’ai toujours sur moi le fameux petit carnet de moleskine noire, mais vous seriez bien déçu d’y découvrir tout ce qui y figure : entre deux fulgurances littéraires, vous y trouveriez la liste des courses ou le calcul de mes impôts…
Êtes-vous un grand lecteur ? Considérez-vous que la lecture doit nécessairement précéder l’écriture ?
Non aux deux questions, mais avec des nuances. J’ai toujours une lecture en cours, y compris lorsque je suis moi-même dans un temps d’écriture, mais je lis très lentement, non sans une certaine impression de labeur, presque avec un sentiment de devoir. Si je lis trois livres dans le mois, ce mois-là sera à marquer d’une pierre blanche. Surtout, et comme nombre d’auteurs sans doute, je me désole parfois de ne plus pouvoir lire avec la même innocence ravie que naguère. Bien que m’en défendant, je ne parviens plus à lire les autres sans chercher à les percer à jour, à digérer leurs formes, sans me transformer en vampire. En revanche, j’entreprends toujours de les lire avec un élan de ferveur, une forme instantanée, instinctive, d’estime et de sympathie. Je trouve toujours quelque chose à sauver dans un livre, c’est plus fort que moi. Je n’ai aucun goût, et moins encore de légitimité, pour la descente en flammes telle qu’elle se pratique en France, non sans quelque excessive gourmandise. Maintenant, quant à savoir si la lecture doit précéder l’écriture... En raison, je vous répondrai que oui, sans doute : c’est dans les musées qu’on apprend à peindre ; il n’en est pas moins vrai, si vous me permettez de poursuivre sur cette lancée, que c’est aussi en forgeant qu’on devient forgeron… Aussi, pour résumer avec autant d’exactitude que possible, disons que j’ai dû venir à l’écriture en lisant, mais que je n’écris plus guère qu’en écrivant.
Quels sont les auteurs qui vous ont façonnés ?
Vous me pardonnerez cette réponse peut-être démagogique : tous. Mieux – ou pire : tout ce qui est écrit me façonne. La lecture d’une notice pharmaceutique peut me procurer, non seulement des idées, mais des ingrédients stylistiques. Si je réponds à votre question avec toutes les références requises, je serai aussi honteusement incomplet que formidablement ennuyeux : je citerai tous ceux que, décemment, l’on ne peut pas ne pas considérer comme d’immenses maîtres, les grands génies de ce monde, inaccessibles à toute esbroufe critique. Ceux que, de manière assez désinvolte, l’on se contente de qualifier de « classiques. » Maintenant, je veux bien essayer d’affiner un peu, même si je cultive le vice et la vertu de l’hétéroclite. Pour m’en tenir à mes contemporains français, j’ai une admiration littéraire sans borne quoique idéologiquement raisonnée pour Richard Millet ; pour ne rien dire de Christian Gailly, Alain Fleischer ou André Blanchard, injustement négligé. Quelque chose me touche beaucoup dans le découragement de Michel Houellebecq, un sentiment de reconnaissance immédiate, de complicité animale, qu’il doit peut-être veiller à ne pas gâcher. Beaucoup d’autres encore, quelqu’un comme Jack-Alain Léger par exemple, que je regrette de n’avoir connu que sur le tard, grâce à ma femme. Tous, à leur manière, par d’insondables voies, me ramènent à moi, et peut-être à ce qui demeure en moi d’irrémédiablement français. Mais ce que j’aime par-dessus tout, c’est sortir de ce qui m'affaire. Moyennant quoi, je prends toujours quelques leçons désespérantes et définitives avec Juan Manuel de Prada, Richard Powers, Antonio Munoz Molina, José Saramago, Paula Fox, J.G. Ballard, Dashiell Hammett, Raymond Chandler, Donald Westlake, jusqu’à Jeffrey Deaver ou Stephen King. Je me demande juste ce que je fais de ces lectures. Ou ce qu’elles font de moi.
Avez-vous commencé un nouveau roman ?
Oui, et davantage encore. Mais c’est long, imprévisible, et jamais satisfaisant. Pour tout vous dire, j’ai pratiquement terminé un roman, deux autres font semblant de dormir sur l’établi, quelques idées macèrent dans leur coin, et j’attends un peu avant de faire paraître une réflexion sur le travail d’écriture. J’attends, en fait, d’être au point avec moi-même sur ce sujet tellement galvaudé…
Vos nouvelles sont noires, sombres, tragiques. Votre écriture mêle humour et regard anthropométrique sur les individus et la société. Une forme de pessimisme ou une façon de faire passer la pilule ?
Je ne les crois pas si noires que cela. Mais il est vrai qu’elles ne feront rire qu’à la condition de partager avec le narrateur un regard aimablement amer sur l’épopée humaine et individuelle. Je ne m’attache pas spécialement à exhumer le petit tas d’immondices et de secrets dont l’humain est aussi fait, je me borne à enregistrer notre perpétuelle tentation maléfique. Voyez-vous, je crois davantage au Diable qu’à Dieu, même si l’assertion est théologiquement irrecevable... Si le Diable a ce visage éminemment sympathique, ce n’est pas seulement en ce qu’il représente la tentation, ça c’est un truc pour la catéchèse ou les ligues de vertu, mais parce qu’il impose un retournement des certitudes, des lieux communs, du socle moral un peu stupidement collectif qui nous constitue. Jésus fut révolutionnaire, le Diable ne cesse jamais de l’être. Je suis sans doute infiniment plus français que J.G. Ballard, mais je me retrouve beaucoup dans ce que je perçois de lui. Lisant Sauvagerie, récemment, je me suis senti en très étroite communauté d’intention avec lui, avec cette espèce de gravité sociologique autour de laquelle il fait tourner ses angoisses mâtinées de drolatique et d’abattement. Ce n’est pas du cynisme, plutôt un accablement qu’il s’agit à chaque instant de dominer, et de dépasser. Maintenant, je crois en effet que je suis habité par une forme très ancienne de pessimisme historique, dont, chacun à leur manière, mes livres précédents témoignaient déjà. Pessimisme qui exprime tout autant la forme irréfléchie de mon rapport au monde qu’une méthode un peu naïve pour contourner ou ajourner le désappointement ou le malheur. J’en ignore l’origine. Cela dit, je ne souhaite en aucun cas l’identifier.
Comment traitez-vous le matériau que représente votre propre expérience, votre vécu, lorsque vous écrivez ?
Etrangement, ce recueil constitue sans doute le plus autobiographique de mes livres. Etrangement, parce que, sur le papier, Et je dirai au monde toute la haine qu’il m’inspire, mais plus encore Monsieur Lévy, était hantés par mon expérience, ils s’y nourrissaient expressément. Mais la joie évoquée plus haut à propos de ces nouvelles tient sans doute au fait que je crois avoir réussi, quasiinconsciemment, à faire du matériau biographique intime une pure matière à création. Pour autant, rien de ce qui a pu ou peut être fondamental dans ma vie n’apparaît ici ; à l’exception notoire, revendiquée, de l’histoire de ce jeune homme hospitalisé, pour ne rien dire évidemment de la déclaration d’amour qui clôt le recueil… En revanche, ont remonté à la surface de ma mémoire d’innombrables détails, anecdotes, paysages, caractères, qui apparaissent donc ici entièrement fondus, dégorgés, si je puis dire, dans la centrifugeuse à recréation.
Un personnage revient dans chacune de vos nouvelles, sous des traits toujours différents, celui de Géraldine Bouvier. Qui est-elle ?
Je ne sais pas. Un horizon, un indice, une allégorie, une obsession, un gimmick, que sais-je encore. Peut-être incarne-t-elle ce lecteur inaccessible dont j’ai besoin pour écrire, cette âme qui accompagne sans juger. Un témoin, en quelque sorte.

/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)


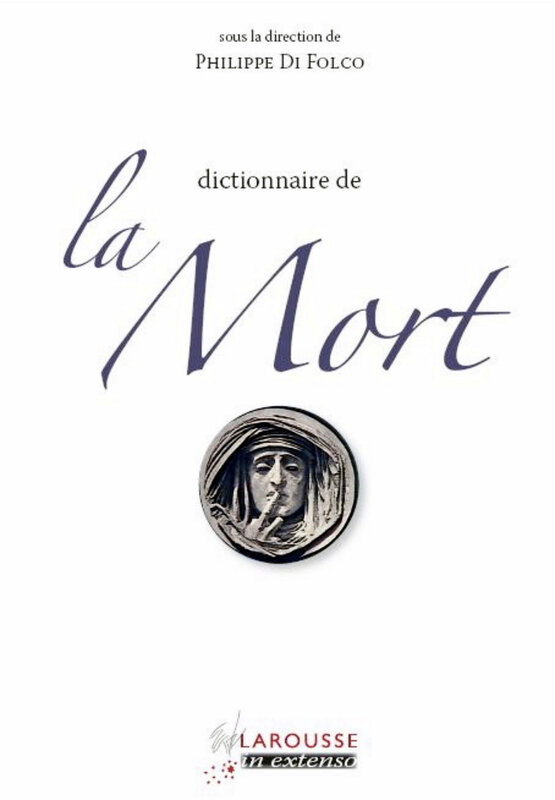





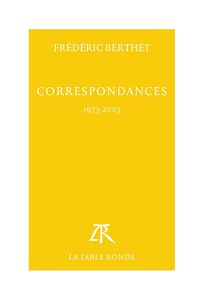



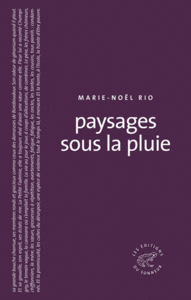

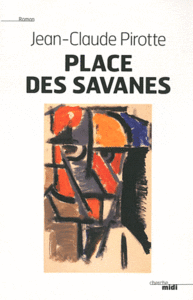









/image%2F1371200%2F20240318%2Fob_1eae77_image-2.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240229%2Fob_384f1a_image-1.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240321%2Fob_66458e_71dsd7uv-8l.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240229%2Fob_cdde8f_image-7.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240229%2Fob_f7a112_image-9.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240303%2Fob_c1fc8b_image-1.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240303%2Fob_a4648f_image-1.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)