Tombeau - Dictionnaire de la Mort
Dictionnaire de la Mort, (s/d) Philippe Di Folco - Éditions Larousse, collection In Extenso
Notice Tombeau - Marc Villemain
En Occident, jusqu'au XVIIIème siècle, l'on ne fait pratiquement pas de distinction entre une tombe et un tombeau, même si la tombe tendait plutôt à désigner l'espace funéraire, le tombeau passant pour synonyme de mausolée. Dans la langue française contemporaine, la distinction est plus nette : la tombe est le lieu même où est ensevelie la dépouille, la fosse où elle est déposée, tandis que prend la dénomination de tombeau l'ornementation architecturale qui signale la présence de la tombe et invite au recueillement. Si les tombeaux servent à la fois de signalétique et de mémorial, il n'en a pas toujours été ainsi. Sous l'Ancien Régime, une dalle, recouvrant le caveau souterrain et ne portant parfois qu'un simple numéro, pouvait marquer l'emplacement de la sépulture ; les signes distinctifs permettant d'identifier le défunt (initiales, épitaphe, armes, blasons) pouvaient quant à eux être fixés sur un mur.
Commémorer
Un tombeau est donc avant tout un monument commémoratif, le plus souvent érigé sur un lieu de sépulture. A l'usage, ce qui distingue la tombe est son prestige, ses dimensions, son architecture ; autrement dit, les tombeaux sont en général destinés aux personnalités, aux grandes familles, ou encore aux édifices isolés, comme les chapelles funéraires. Ainsi peut-on admirer le tombeau de Napoléon, déposé le 2 avril 1861 dans l'église du Dôme des Invalides, à Paris, que l'architecte Louis Tullius Joachim Visconti réalisa dans des blocs de quartzite rouge placés sur un socle de granit vert et cerné d'une couronne de lauriers. Les tombeaux ne contiennent pourtant pas nécessairement la dépouille charnelle complète. Ainsi exista-t-il des tombeaux des entrailles et des tombeaux du cœur : comme leur nom l'indiques, ils ne contenaient que ces organes distincts. A l'époque médiévale, il n'était pas rare de distinguer un tombeau des entrailles en plaçant une poche sur la poitrine de l'effigie. Parfois, ces deux tombeaux spécifiques ne contenaient qu'un vase, dit urne de viscères ou urne de cœur, selon son contenu. Parmi les exemples les plus fameux, l'on peut citer le tombeau des entrailles de Charles V, qui provient de l'ancienne église abbatiale cistercienne de Maubuisson (Val d'Oise), et que l'on peut aujourd'hui visiter au musée du Louvre.
Symbolique
Le caractère sombre et éploré des sépultures d'Occident ne date pour l'essentiel que du XVIè siècle. Le mouvement prend son essor à la fin de la Renaissance, soutenu, non sans quelque paradoxe, par la chrétienté, laquelle pourtant ne craint pas de cultiver une certaine image rédemptrice et émancipatrice de la mort. Aussi nombre de tombeaux sont-ils l'objet d'un véritable décorum mortuaire, où l'on n'hésite pas à orner le lieu d'allégories de squelettes ou de cadavres rongés, esthétique largement relayée par le romantisme. Aucune dramaturgie de la sorte n'existait en revanche au Moyen Age : à l'instar de l'Antiquité grecque et romaine, qui parsemait les voies de circulation de tombeaux au pied desquels il était commun de venir deviser de choses et d'autres, l'inexorable finitude ne l'impressionnait guère. Toutes les civilisations ont toujours mis un soin particulier à ériger de remarquables tombeaux. Ainsi du tombeau des Askia, au Mali, pyramide édifiée en 1495 par Askia Mohammed, empereur de Songhaï, au sein d'un ensemble comprenant donc, outre la pyramide tombale, deux mosquées, un cimetière et un espace de délibération. Mais lorsqu'on évoque les pyramides, c'est aux pyramides égyptiennes que l'on songe, et il est remarquable de penser que celles-ci, dont celle de Gizeh compte au nombre des sept merveilles du monde, sont d'abord des tombeaux verticaux. La forme pyramidale est née lorsque Djéser, roi de la IIIè dynastie, exprima le souhait que l'on agrandît son tombeau, à l'origine un simple mastaba. Le mastaba est une construction rectangulaire destinée aux pharaons et à la noblesse qui faisait à la fois office de sépulture du défunt et de lieu de résidence pour son ka, c'est-à-dire, sommairement, son double spirituel, une partie de son âme. C'est au fil de l'Ancien Empire égyptien que leur architecture évoluera, jusqu'à devenir les pyramides à degrés que l'on connaît.
Les tombeaux sont-ils condamnés à ne plus susciter que l’intérêt ou l’admiration de quelques esthètes et autres archéologues ? sommes-nous condamnés à ne plus reposer que dans des demeures javellisées, conformes aux impératifs de l’aménagement urbain et à la tentation paysagère, aux normes sanitaires et à l’anonymat égalitaire, égarés que nous serons dans d’immenses parcs aux allures de réserves futuristes, elles-mêmes soumises aux caméras de sécurité de l’intérêt général ? Lequel d’entre nous pourra ou sera même autorisé à ériger un nouveau Taj Mahal en hommage à sa bien-aimée ? Quel Christ pourra quitter son tombeau sans que nulle police ne s’en aperçoive ? Questions loufoques, à n’en pas douter, mais qui prouvent, fût-ce par l’absurde, combien l’imaginaire humain trouve à se nourrir dans le destin des morts. Les tombeaux sont les témoins du temps, et l’on pourrait reconstituer l’histoire de l’humanité en s’attachant à ce qu’ils ont représenté au fil des siècles. Et si le juste souci démocratique se défie des singularités trop fortes et des entreprises à la fois trop romantiques et trop onéreuses, il n’est pas douteux que la mort et le destin de la dépouille mortelle des humains continueront de charrier une esthétique en perpétuel renouvellement. Le goût de la démocratie étant aussi celui de l’individu, alors il n’y aurait rien de surprenant à ce que, vaille que vaille, de nouveaux tombeaux sortent peu à peu du sol, premières pierres, peut-être, des merveilles de demain. A moins, comme certains en cultivent le rêve et en entretiennent parfois le projet, que l’on puisse un jour se faire inhumer ailleurs, bien ailleurs : dans l’espace, sur la lune ou sur Mars.
M. Villemain
Bibl. : Danièle Porte, Tombeaux romains – Anthologie d’épitaphes latines, Gallimard, 1993 * Richard Lebeau,Pyramides, temples, tombeaux de l’Egypte ancienne, éditions Autrement, 2004 (beau livre) *

/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)








 Q
Q



/image%2F1371200%2F20240310%2Fob_1658b7_image-3.jpeg)
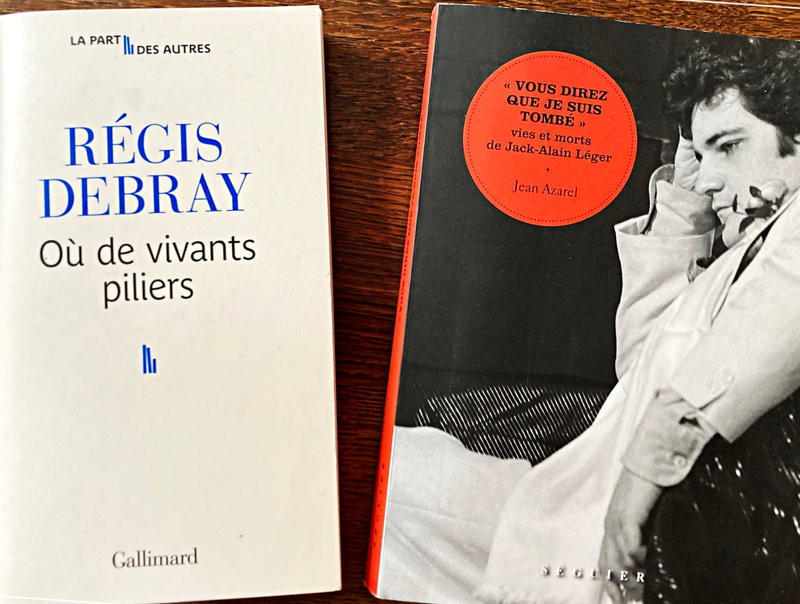
/image%2F1371200%2F20240327%2Fob_6ff67d_image-5.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240329%2Fob_669535_image-32.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240330%2Fob_20cd4d_lo0067.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240401%2Fob_e81810_image-89.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240401%2Fob_a63f41_image-90.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240402%2Fob_a44f49_image-158.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240404%2Fob_e56d93_image-178.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240401%2Fob_ecc5cc_image-134.jpeg)



/image%2F1371200%2F20240404%2Fob_ea7c1e_image-196.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240405%2Fob_df13a6_image-221.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240406%2Fob_3941d4_image-240.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240406%2Fob_91421d_image-241.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240406%2Fob_fcf66a_image-246.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240331%2Fob_6fb73f_capture-d-ecran-2024-03-05-a-09-57.png)


/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)