Straight life, Art Pepper, Éditions Parenthèses.
Traduit de l’américain par Christian Gauffre, préface de Philippe Carles.
Critique parue dans Esprit Critique - Newsletter de la Fondation Jean-Jaurès - juin 2003

1957. La scène se passe au Blackhawk, un club de San Francisco. Art Pepper joue avec sa formation du moment. Je pense qu’il y a Brew Moore avec lui, un bon ténor. Arrive Sonny Stitt, l’autre grand altiste du moment. Ils échangent un mot, ça sent la compétition à plein nez, et Art en a horreur. On tombe d’accord pour jouer Cherokee, thème difficile, très rapide, avec des modulations un peu folles sur le pont. On expose le thème, Sonny Stitt prend le premier chorus. Il en prendra quarante. Il ne s’arrête pas, ça dure une heure. Quarante grilles qui tournent, pas une fausse note, pas une faute de goût, pas une mesure échouée, section rythmique à l’affût, Sonny Stitt est un musicien exigeant. Pepper est tétanisé. Défoncé, surtout. Il vient d’avoir une scène avec Diane. Elle a menacé de se tuer dans sa chambre d’hôtel, assise au bord de la fenêtre, une lame de rasoir dans la main, elle n’en peut plus, elle veut juste qu’il l’aime, qu’il l’aime vraiment. Folle de rage, elle a mis toutes ses affaires à tremper dans la baignoire, lui qui n’avait déjà rien, même sa clarinette à quatre cent dollars, finie, rouillée ; terminé. Il a les bras démolis, des traces de piqûres dans chaque veine, et les stups qui veillent dans la salle. Le chorus de Sonny touche à sa fin, le public est aux anges, ça hurle, siffle, applaudit à tout rompre. Pepper est ailleurs. Sonny le regarde. Les musiciens l’attendent, ils font tourner une grille, deux peut-être, allez savoir. Puis il comprend. Alors il joue au plus haut de son art. Altère le registre de Stitt, prend le contrepied, n’en fait qu’à sa tête, il part, éblouissement, ce n’est plus de la musique, c’est Art Pepper mis en musique. C’est lui qui dit ça. À la fin ils se regardent, avec Sonny, un signe de tête, quelque chose de viril et doux, les musiciens sont souvent comme ça, parfois c’est agaçant, enfin toujours est-il que les deux se comprennent, se sont compris. Le public est survolté. Ils ont devant eux, là, sur la scène, les plus beaux musiciens du moment, ceux qui donnent tout, qui ont toujours tout donné, qui n’ont jamais eu que la musique pour dire l’urgence de vivre. Et s’agissant d’Art Pepper, celle de crever.
Cette scène, Pepper la raconte en conclusion de son autobiographie. Mais il y en a des dizaines comme ça. Je l’ai choisie pour commencer parce que lui-même l’a choisie pour conclure. Mais j’aurais pu commencer par une autre. Celle du 19 janvier par exemple, la même année, quand Diane organise sans lui dire un enregistrement avec la section rythmique de Miles Davis. Ils sont tous là : Paul Chambers à la contrebasse, Phillie Joe Jones à la batterie, Red Garland au piano. Le grattin, des types qui jouent tous les soirs, toutes les nuits, des heures durant. Mais voilà, ça fait six mois que Pepper n’a pas joué une note, même pas touché son instrument. Il sort tout juste de Terminal Island, le pénitencier de Los Angeles. Art pose son alto sur le lit, l’anche sent le moisi, il faut tout démonter, tout nettoyer, ni le temps, ni le courage. Alors c’est comme ça qu’il va jouer, qu’il va jouer avec les monstres sacrés. Il connaît à peine les mélodies, comme souvent. Et ça donne Art Pepper meets the rhythm section, un de ses meilleurs albums.
En lisant Pepper, j’ai souvent pensé au Seigneur des porcheries, le premier roman, magnifique, de Tristan Egolf. En plus urbain. Faudrait aussi voir du côté de Kérouac. Mais au fond c’est la même Amérique, celle, née au milieu des années vingt, qu’on va envoyer faire la guerre en Europe, comme Art lui-même, et qui sait bien que le rêve américain est un truc pour les étrangers. Son père fuira la maison familiale à l’âge de dix ans et rejoindra les docks de San Pedro : labeur, alcool et violence. Sa mère ne voulait pas de lui, elle s’enfoncera un cintre dans le ventre. En vain : Art débarque sur Terre à l’automne 1925, malade, rachitique, avec la jaunisse. Il est prévu qu’il meurt, il ne tiendra pas deux ans c’est sûr. Et puis ça ira, finalement. Car Pepper est né avec ce que d’aucuns nommeraient un don, qui n’est rien d’autre que la fatalité : la sienne à lui, c’est son génie. Alors il a peur de tout, il se trouve différent, et déjà il veut tant qu’on l’aime. Thelma, belle-mère qu’il aurait adoré avoir pour mère, dira de lui que c’était « un vrai petit cadavre ambulant ». A l’école il se bat pour plaire à son père, empêchant même ses plaies de cicatriser. Il est obsédé par le sexe. Pas les filles, le sexe. Il était beau, le Pepper. De la trempe d’un James Dean. Une nonchalance de chat dans un corps brut. Une indolence ténébreuse et muette, une réserve, une solitude d’animal exalté, quelque chose de la morbidezza. Toutes les femmes le regardent, le convoitent, elles déclarent leur flamme, déclament leur amour, elle veulent l’aimer, oui, sans doute, mais plus encore je crois qu’elles veulent l’aider, l’aider passionnément. Il courra derrière l’amour et ne saura qu’en faire quand il sera là. Sauf à la fin, à la toute fin, et encore, quand il rencontrera Laurie, dans un hospice bizarre, sorte de secte d’Etat pour toxicos désoeuvrés. C’est Laurie qui le sauvera, qui lui permettra de rejouer. Et c’est à elle que nous devons ce livre, la parole d’Art Pepper enregistrée sur un magnéto, retranscrite avec admiration, lucidité, amour.
Mais tout ça c’est plus tard. Avant il faudra passer par les prisons, les injustices, les hôpitaux, le succès. Pour l’instant il n’est qu’un enfant. Son cousin joue de la trompette, il adore, mais les dents ébréchés par les parties de football lui interdisent l’instrument. Alors ce sera clarinette. Quand il se bat dans la cour, son premier réflexe, c’est de protéger sa bouche. Car il le sait, déjà, et il le dit : « Je serai un si grand musicien que mes manières n’auront plus aucune importance ». Il a neuf ans. À la radio, ils passent le Concerto for Clarinet d’Artie Shaw ; alors il se met à le travailler, tout seul, lui qui sait à peine lire la musique et ne connaît rien à l’harmonie – il ne s’y mettra d’ailleurs que bien plus tard, quand la gloire sera déjà là. À quatorze ans, il joue dans l’orchestre de Lee Young, le frère de Lester, son alter ego en lyrisme. Et il traîne avec Dexter Gordon, il prend de l’herbe, des comprimés, ne va pas, ou si peu, à l’école. Il joue trop pour ça. Quand Benny Carter l’embauche, il n’a que seize ans. Puis Stan Kenton, un an plus tard. Le grand Stan Kenton, avec son orchestre, son savoir-faire, sa réputation, sa mécanique bien huilée, ses tournées mondiales. Stan Kenton, avec qui il donnera jusqu’à sept concerts par jour. Car sur le fond, tout Pepper est déjà là : le gosse ultrasensible, celui que la vie effraie, qui donnerait tout pour être aimé et laisse tout tomber dès qu’on l’aime, qui se sent tellement coupable de tout, qui ne donne personne, jamais, pas même en prison, jamais, le camé aux fêlures trop profondes pour saisir le bonheur quand il passe, le trop-vivant pour réussir un suicide, il est déjà là, il est déjà le musicien qui, d’oreille, joue les trucs les plus invraisemblables, et mieux que tout le monde. Il ne changera plus. Il accumulera juste plus de shoots, plus de balafres, plus de cachots. Dix-sept nuits sans dormir dans une cellule de Los Angeles, tétanisé par le manque. Ou à Saint-Quentin, la prison symbole réservée aux plus violents, six mille prisonniers pour mille cinq cent places, les chiottes bouchées, le liquide infect qui rampe sous le matelas, les cafards qui jaillissent par dizaines du moindre croûton de pain. Ces prisons américaines d’antan qui ressemblent à certaines des nôtres aujourd’hui, et à côté desquelles l’armée, pour Art, fut « un paradis de chaleur humaine ». La vie est un drame, et le drame lui échappe. Je pense qu’il pense juste que c’est ça la vie, que c’est comme ça. Et même qu’il n’a pas vraiment envie d’autre chose.
Straight Life, par ailleurs le titre d’une de ses premières et plus fameuses compositions, n’est pas une plongée dans le jazz. On y croise des musiciens bien sûr, des ambiances, des clubs, des histoires d’instruments, de rivalités, de drogues et de femmes. Mais c’est d’une fresque dont il s’agit. La fresque d’un homme qui passe des clubs aux pénitentiers sans jamais avoir revendu un gramme de quoi que ce soit, mais qui en a juste trop, beaucoup trop consommé. Des dizaines de capsules d’héroïne par jour. Et pas suffisamment d’argent pour en acheter d’autres, malheureusement. Sans compter l’herbe, les acides, la cocaïne. Et l’alcool. La fresque d’un musicien qui restera parmi les plus grands souffleurs de l’histoire, qui planera sur ses journées en volant pour pouvoir s’acheter ses doses quotidiennes, et qui pourtant n’aura eu de cesse de mener une straight life, une vie droite. Bien sûr, ce n’est pas la droiture de la société qui réprime et légifère ensuite pour justifier la répression : c’est la droiture d’un homme que l’on dirait comme programmé pour des embardées dont on se dit parfois qu’elles sont raisonnables tant vivre est une chose folle, et qui se tue à anéantir ses peurs, sa culpabilité, son enfance. Il est lucide, Pepper. C’est pourquoi sa parole est touchante. Même, surtout, quand il dit que les choses auraient été plus facile s’il n’avait pas eu autant de talent. Il ne fanfaronne pas quand il dit ça, il soupire. Et puis c’est la fresque, aussi, bien sûr, de cette Amérique pauvre et misérable d’avant la guerre, avec son orgueil, ses codes d’un honneur fabriqué par une violence qui vibrionne, toujours, partout, en chacun. Avec sa bêtise aussi, son racisme, son machisme, et Pepper n’y échappe pas. Mais tout ça est tellement plein de vies brisées, dès la naissance, dès le lieu de naissance, dès la première confrontation avec la société des hommes. Au final, pourtant, je regarde flotter sous mes yeux l’image d’un homme à la fragilité de verre, à la douceur presque animale, aimant comme un gamin, haïssant comme un ado, et qui s’écroule à quarante ans dans les bras du père ruiné à force de payer les cautions ou les soins.
Il y a deux écoles : prendre une oeuvre sans considération de son auteur, sans son tissu charnel, sans ontologie, sans déterminismes, une oeuvre comme un miracle, humaine, certes, mais tellement plus grande que l’homme : une oeuvre comme une transcendance ; ou le contraire : pas d’homme, pas d’oeuvre ; pas de chair, pas de sang, pas d’oeuvre ; la jauger à l’aune de ça, à l’aune du temps, de la culture, de la tripe. Je n’ai jamais su que faire de tout ça. Je passe de l’une à l’autre école. Il faut bien qu’une oeuvre ait un écho universel pour mériter son statut. Mais que serait-elle si elle n’était que divine ? Ce qui est sûr, c’est que je ne pourrai plus écouter Art Pepper de la même manière, maintenant que je l’ai lu.


/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)








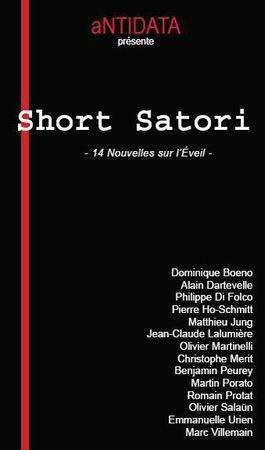
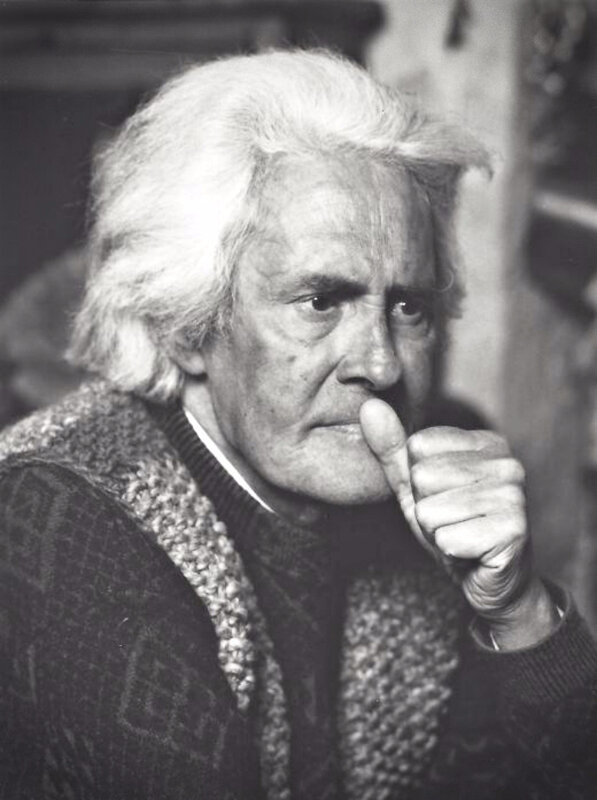






















 À Marie.
À Marie.

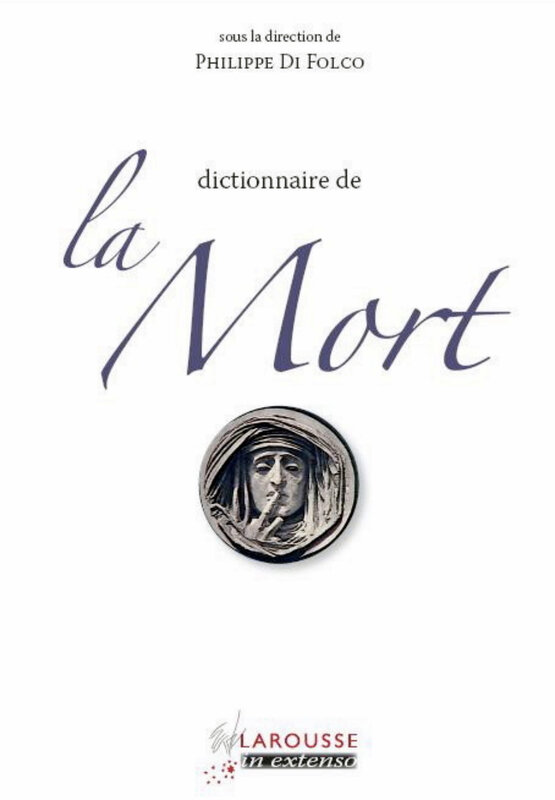

/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)