 Entretien avec Nicolas Vidal lors de la parution de Et que morts s'ensuivent.
Entretien avec Nicolas Vidal lors de la parution de Et que morts s'ensuivent.
BSC NEWS MAGAZINE – Numéro 14 – Mars 2009
Nicolas Vidal. Marc, vous avez plusieurs casquettes : critique littéraire au Magazine des Livres et auteur. Quel est le fil conducteur qui relie entre eux ces deux rôles ? Ne sont-ils pas antagoniques ou du moins peu évidents à concilier ?
Marc Villemain. Ne le prenez pas mal : votre question est plus intéressante qu’il y paraît. C’est qu’elle a, d’emblée, quelque chose d’un peu saugrenu : quel antagonisme pourrait-il bien y avoir entre le fait d’écrire des livres et de s’exercer à un travail critique sur d’autres livres ? Que je sache, l’écrivain n’est pas nécessairement moins bon lecteur que n’importe quel autre lecteur ! Et, à cette aune, peut bien avoir quelque chose à écrire sur d’autres livres que les siens propres. Le fil conducteur dont vous parlez, c’est donc, simplement, la littérature, les mots. Cela étant, entre les lignes, votre question suggère une réflexion d’ordre, disons, plus déontologique. Il est vrai que chaque travail critique me place en quelque sorte devant un cas de conscience. D’abord, je ne suis pas un critique au sens estampillé de la chose, et mon oeuvre n’est sans doute pas à ce point exemplaire ou mémorable qu’elle me permette de faire état d’une quelconque autorité littéraire. Il est vrai aussi que je ne peux formuler de jugement, fût-il enthousiaste, sur un livre, sans chercher dans celui-ci quelque chose qui entre dans une sorte de résonance avec mon propre travail d’écriture ou mes propres recherches. Je veux dire par là que ce que j’aime, la littérature que je défends, dépend aussi, consciemment ou pas, de ce que je voudrais, pourrais ou ne pourrais pas écrire. En d’autres termes, il m’est difficile de lire le moindre livre sans chercher à en repérer la mécanique, les structures, les idiotismes, afin de les assimiler et d’en faire bénéficier mes propres livres. La vie (littéraire) est un perpétuel noviciat...
En tant qu'auteur publié, comment expliquez-vous toutes les difficultés que rencontrent les auteurs inconnus pour publier leurs livres ?
Peut-on dire que c’est à ce point difficile quand jamais il n’a été publié autant de livres et d’auteurs ? Je crois toutefois comprendre ce que vous voulez dire, mais il me sera difficile d’y répondre avec toute l’exhaustivité requise. Je vais me risquer à un poncif économique : l’offre est bien trop grande pour la demande. Trop de livres, pas assez de lecteurs. La mécanique qui régit l’économie du livre est absolument aberrante, vouée à de très profondes et sans doute douloureuses réformes. Ce mouvement n’est pas encore très net, mais je pense que nous entrons dans les premières années d’un certain reflux, qui expliquerait en partie que d’aucuns éprouvent quelque difficulté à trouver éditeur à leur pied. Ce à quoi je m’empresse d’ajouter que l’arrivée programmée du livre numérique et autres supports nomades ne changera pas grand-chose à cette situation : la sélectivité n’en sera que déplacée. Vous savez comme moi qu’on « pilonne » chaque année 100 millions de livres : aucun autre secteur économique, aucune autre entreprise ne supporteraient plus de quelques semaines une telle déperdition, un tel gaspillage. Alors la question, bien sûr, est de savoir pourquoi l’on publie bien plus que ce que les lecteurs peuvent humainement ingurgiter – ou que ce que le marché peut absorber. Outre les calculs économiques (erronés) des éditeurs, assis sur l’idée selon laquelle plus grande est l’offre, plus on diversifie le lectorat et plus on démultiplie la clientèle, je vois à cela une dimension plus souterraine, liée à un double phénomène de civilisation. Nous vivons un temps un peu égaré, dans une société qui échoue en partie à se comprendre et à se reconnaître elle-même. Il est possible que le livre apparaisse, ne serait-ce qu’en vertu de son ancienneté, comme une valeur refuge, un outil irremplaçable pour formuler une pensée apte à nous guider dans l’histoire du monde. Nous écrivons, nous publions, parce nous cherchons de manière effrénée à nous comprendre, à la fois comme ensemble social et comme monade disséminée dans cet ensemble. Enfin, je crois que nous vivons un temps de désacralisation progressive du livre, de l’écrit, de l’écrivain, désacralisation qui, en un apparent paradoxe, conduit un nombre croissant de personnes, non seulement à vouloir écrire (de cela il y aurait tout lieu de se réjouir), mais surtout à vouloir être lu – donc publié. Poussé aux confins de l’absurde, ce modèle conduirait à ce que chaque auteur n’ait plus en fin de course qu’un seul lecteur : lui-même. Si nous défendons une certaine idée de la littérature, si nous défendons, autrement dit, une certaine exigence éthique et esthétique, alors nous devons nous réjouir qu’il ne soit pas aussi simple que cela d’être publié. Je mets les pieds dans le plat : tout le monde ne peut pas être écrivain. Et il ne s’agit évidemment pas, ce disant, de réserver cette « activité » à je ne sais quelle élite, mais tout simplement d’admettre que se vouer à l’écriture ne convient pas à tout le monde et va de pair avec un certain tempérament, une certaine complexion personnelle. Donc, non seulement il n’est pas grave que tout le monde ne puisse pas être écrivain, mais c’est tant mieux.
Marc, qu’est-ce qui vous a poussé à écrire ?
Je ne suis pas sûr de le savoir et ne le saurai probablement jamais – ne serait-ce que parce que je ne cherche pas spécialement à le savoir. Les choses sont trop complexes, trop enchevêtrées. Aucune causalité n’est fondamentalement ni distinctement identifiable. J’ai écrit, j’écris, parce que l’écriture m’offre un espace, une circonstance et une consistance sur lesquelles je peux m’appuyer pour atteindre à une certaine forme de plénitude, d’introspection et d’intelligence. C’est ma façon à moi d’approcher au plus près d’une solitude désirée ou, pour renverser les termes de la proposition, de me maintenir le plus éloigné possible d’une solitude subie. J’écris parce que je ne me sens jamais autant ouvert aux possibilités existentielles et métaphysiques, cérébrales et physiques, que dans le temps de l’écriture. J’écris parce que je peux éprouver un plaisir un peu trouble à constater que ce que j’écris est en général plus intelligent que moi : c’est aussi ce franchissement, ce dédoublement qui est enivrant. Je constate, en écrivant, l’inadéquation, même relative, entre ce que j’écris et ce que je suis. Quand on écrit, on explore, presque sans le savoir, quelque chose de soi que l’on est
d’ordinaire incapable de localiser en soi.
Et que morts s'ensuivent est une satire sociale. Du cocasse à l'absurde et toujours porté par une élégance de style, la lecture est délicieuse. Etaient-ce les objectifs recherchés lorsque vous avez commencé à écrire ces nouvelles ?
Je ne suis pas certain qu’il s’agisse d’une satire sociale. En tout cas telle n’était pas mon intention. Il y a de la satire, oui, et sociale, pourquoi pas, mais je dirais qu’elle est plutôt ontologique. C’est une sorte d’exploration de ce qu’il y a de définitivement moyen en nous, en chacun d’entre nous. Une manière d’exposer les limites de nos grandes fiertés humanoïdes. De défier le sens commun, les acceptions communes, les valeurs indiscutables. De m’amuser de nos certitudes collectives autant que de nos passions singulières. De faire peur en racontant des histoires qui, pourtant, ne sauraient être plus humaines. On pourra y voir du cynisme, et il y en a peut-être. Mais je revendique aussi une forme de désolation et d’abattement. Ce pourrait être, finalement, le livre d’un humaniste que l’humanisme déçoit. Pour autant, je ne crois pas avoir eu d’intention particulière. Ces histoires m’ont entraîné et je me suis laissé prendre à leur jeu, à leur mouvement interne. Bien sûr, en les retravaillant, j’ai exercé sur elles un contrôle plus ou moins souverain, leur appliquant un ensemble de pensées, de volontés, de directives, mais le fait est qu’elles m’ont en grande partie échappé, et que là réside d’ailleurs le plaisir très intense que j’ai éprouvé à les écrire. Mais il est vrai que les ai voulues caustiques, cocasses, déchirantes, dramatiques, pathétiques. A l’image peut-être de ce que peut m’inspirer un certain pan de l’aventure humaine.
Les personnages sont liés entre eux et entre les nouvelles. C'est une sorte de roman travesti en recueil de nouvelles qui décrit l'accumulation de drames humains. Qu'est-ce qui vous intéresse dans cette façon de dépeindre une réalité sociale ?
Ces personnages ne sont pas liés, si ce n’est par l’intermédiaire de l’un d’entre eux, qui revient en permanence sous des traits toujours différents, et qui pourrait incarner quelque chose comme un dénominateur commun, un parangon ou un échantillon d’humanité. Mais ce n’est pas un roman. Ce sont des nouvelles, liées seulement par un esprit, un style, et, en effet, une dramaturgie. Encore une fois, je n’ai pas vraiment cherché à dépeindre une quelconque réalité sociale, même si je le fais incidemment afin d’épaissir les coulisses. En revanche, oui, le drame est là, la mort rôde. Partout, tout le temps. Pour quelle raison, je ne suis pas certain moi-même de pouvoir le dire… Elle est pour les vivants le seul objet réel de fascination, notre ultime demeure, notre seule projection possible. Elle est inscrite partout sur les murs de la vie, et partout nous l’esquivons, la contournons, la conjurons, et cela est vain et cela créé notre humanité. Il est possible aussi que j’éprouve un certain agacement au vitalisme contemporain, à cette objurgation permanente à la vie, aux innombrables slogans, politiques ou publicitaires, qui n’ont de cesse de vanter la rupture, le renouvellement, le changement, la régénération, la révolution : toutes choses possibles seulement si l’on s’assied sur les morts, ou sur ce qui est passé – autrement dit, pour l’ultra-contemporanéité dans laquelle nous vivons, sur ce qui est mort.
Pensez-vous que la folie peut nous surprendre d'un seul coup, comme cette fille qui crève subitement les yeux de son amie ?
Bien sûr, et depuis toujours ! Mes histoires sont terribles ? Mais elles ne le sont pas davantage que le moindre fait divers dans la vie réelle ! Ce que vous appelez la folie n’est que cette chose très commune que nous nous employons en permanence à tenir à distance respectable. C’est ce qui nous habite, ce morceau de nous-même qui n’est pas moins humain qu’un autre et que nous nous acharnons à endormir, à maintenir à l’état de veille, ou de larve. C’est la source à laquelle nous allons puiser l’énergie que nous mettons, non seulement à survivre, mais à vivre, à nous reproduire, à nous regrouper, à travailler, à organiser, à prévoir. La folie est notre pathologie commune, que nous savons presque instinctivement dominer. Le mystère, c’est lorsqu’elle n’y tient plus, quand la vague finit par dominer et submerger l’individu. C’est, je crois, une longue trajectoire, un très long processus, fait d’une inadéquation à la vie dont je ne suis pas loin de penser qu’elle nous est naturellement commune. Inadéquation à laquelle il faudra bien sûr adjoindre un indémêlable écheveau de souffrances familiales, sociales, intimes. Cette « folie », lorsqu’elle se manifeste, n’est rien d’autre qu’un aboutissement.
Pour finir, que diriez-vous aux lecteurs du BSC NEWS pour les inciter à lire votre dernier livre Et que morts s'ensuivent, paru au Seuil ?
Votre première question m’interdit presque de vous répondre : l’on ne saurait être à la fois écrivain, critique, et critique de ses propres écrits. Moralité : c’est à vous de leur dire !
/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_687865_image-45.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240424%2Fob_5b8386_image.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240424%2Fob_6c00ca_image-1.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240424%2Fob_114297_image-2.jpeg)

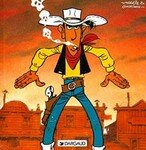



















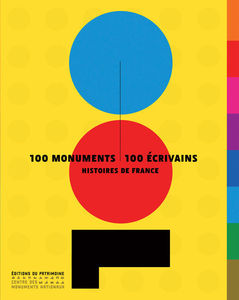


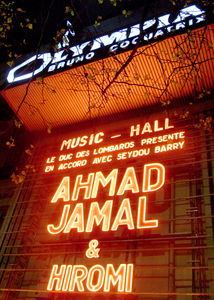




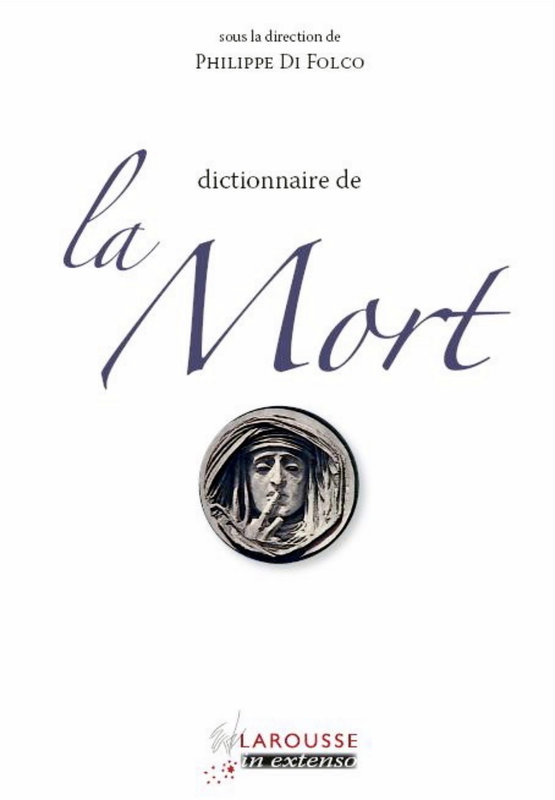










/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)