Le Magazine des Livre, n° 31, juillet/août 2011
Entretien avec Marc Villemain - Propos recueillis par Joseph Vebret
"L'écriture est souveraine"
Dans son quatrième livre, Le Pourceau, le Diable et la Putain, Marc Villemain met en scène un misanthrope mourant à travers un monologue où chacun en prend pour son grade. Réjouissant. Une belle écriture, assurément.

Où avez-vous puisé votre inspiration pour ce nouveau roman, Le Pourceau, le diable et la putain, l’idée, le thème, le fil conducteur ?
Dans l’agonie d’un cloporte : je ne sais donc pas si cela mérite qu’on parle d’inspiration… ! Devant moi, donc, cette bête, les pattes à moitié brisées, cloporte éclopé. C’est ici que la conscience humaine (humaniste, allez savoir) entre en jeu : mon devoir était-il d'abréger son existence en l’écrasant d’un viril coup de talon ? ou était-il plus convenable que je prolonge une vie qui, selon toute probabilité, ne serait plus que d’impotence ? J’ai décidé de laisser faire la nature. Mais, en même temps que je voyais l’animal se dépatouiller, si vous me passez ce terrible jeu de mots, je commençai à écrire ce qui se déroulait, là, sous mes yeux. Et qui, pour en revenir à mon livre, ne sera finalement que de bien faible rapport avec lui ; c’est aussi ce que j’aime, dans l’écriture : qu’elle m’entraîne, qu’elle érige elle-même les conditions de son empire, moissonne de son propre chef la terre que j’irai sillonner. Elle est souveraine, et je lui laisse le plus volontiers du monde la jouissance de ce pouvoir sur moi.
Vos deux dernières productions proposent des formats courts, des nouvelles pour Et que mort s’ensuivent, moins de 100 pages pour ce nouveau roman. Est-ce un hasard ou le choix de vous orienter dans cette direction ?
Je ne décide pas plus du format de mes livres que de leur destination ; tout au plus me donné-je une orientation générale. Je ne peux en constater, comme vous, que le relatif laconisme. Ce qui ne va pas sans m’intriguer, soit dit en passant. La seule explication qui puisse parfois s’esquisser, et qui vaut ce qu’elle vaut, me plaît bien : ayant, à l’âge de dix-huit ans, subi une opération de chirurgie qui m’a privé d’un poumon, j’aime parfois me dire que la brièveté de mes livres serait comme le pendant, la conséquence peut-être, d’un souffle court. Je suis assez séduit, et amusé, par cette correspondance, assurément hypothétique, mais plausible, entre l’esprit et le corps.
Une part d’autobiographie ?
Le personnage principal de ce roman a quatre-vingts ans, il a été professeur d’université, il est mourant et hait son fils par-dessus tout. Accordez-moi au moins cela : j’ai la moitié de son âge, je n’ai connu l’université que de très loin et sur le tard, je n’ai pas trop à me plaindre de ma santé, et je ne suis pas avare d’amour envers mon fils. Non, sérieusement, les péripéties de mon existence ne justifieraient pas à elles seules que je me hasarde en littérature. En revanche, oui, bien sûr, on trouve toujours autour de soi mille et une petites choses dont il peut-être stimulant, enivrant, parfois nécessaire, de faire juter le suc qui, peut-être, irriguera l’œuvre. Dans mon cas, c’est assez secondaire : il s’agit surtout de paysages, de figures, de diverses perceptions, mentales, rétiniennes, de faits très menus et autres circonstances sans importance. Je ne m’en sers que pour fabriquer un décor sur lequel je pourrai asseoir une sensation, une tonalité, où je pourrai dessiner les contours d’un monde nouveau où j’accepterais et aurais envie de me sentir projeté.
Dans un roman, il y a le sujet apparent, l’histoire, qui n’est parfois qu’un prétexte, et le sujet profond, subliminal : qu’avez-vous voulu dire ou faire passer ?
Rien. Je ne veux rien dire, rien faire passer. Je ne suis pas un directeur de conscience, je cohabite avec le dubitatif. Et suis bien trop intimidé par le seul fait de vivre pour me sentir seulement autorisé à dire son fait au monde. Cela dit, il n’aura échappé à personne que je suis un humain, une carne gratifiée d’un vecteur de jugement. Même lorsqu’on ne veut pas regarder le monde, ce qui m’arrive plus souvent qu’à mon tour, on ne peut jamais empêcher le monde de venir à soi. Il a pour cela mille moyens à sa disposition, des intrusions publicitaires aux innombrables modalités du commerce entre les hommes, des bribes de parole recueillies dans la rue aux fréquentations obligées, de l’incrustation de lumière sur le capot d’une voiture au reflet du soleil sur la roche. Je suis ce qu’il convient d’appeler un contemplatif – celui qui considère par la pensée : je ne dis rien : j’éponge, je recrache.
Parallèlement à votre activité d’écrivain, vous vous orientez vers l’édition de fiction. Comment jugez-vous la littérature contemporaine ?
Ce qui m’intéresse dans la littérature est ce qui, chez elle, n’est pas explicitement contemporain – fût-elle, donc, contemporaine. Si l’on entend par littérature contemporaine celle qui intègre, donc officialise, homologue, les réflexes du temps, son lexique, qui donne à son impensé l’apparence d’une substance, éventuellement d’une essence, alors celle-là, en effet, ne m’intéresse pas – ce qui n’induit pas que sa qualité en soit nécessairement mauvaise, cela va sans dire. Ce qui m’intéresse, qui me touche ou m’emporte, c’est quelque chose qui pourrait avoir trait à de l’intemporel, quelque chose dont on pourrait dire, demain, que la part éventuellement contemporaine n’affecte pas l’actualité. C’est, en fait, la possibilité de lire un de mes contemporains en me disant qu’il pourrait être, qu’il sera peut-être, ce que l’on appelait naguère un classique. Tout le sel de cette appréciation induisant que nous soyons capables d’imaginer, non seulement la culture, mais les déterminants, les obsessions, le lexique, disons l’habitus, de nos successeurs et descendants : chose évidemment impossible, mais distrayante, excitante, et peut-être pas aussi vaine qu’il y paraît. Voilà donc un peu ce j’aimerais faire, et réussir comme éditeur : non repérer les classiques de demain, je ne suis pas fou !, mais affûter mon acuité, mon audace, et donner à lire des écrivains dont je sais qu’ils ne seront peut-être pas entendus de nos contemporains, mais dont je pressens, avec la colossale marge d’erreur de rigueur, qu’ils font déjà partie de l’épopée littéraire, d’un temps presque sans borne et sans détermination.

Et l’écriture de la nouvelle génération ? Parleriez-vous de diversité ou de normalisation ? Le style est-il encore une priorité ? Qu’en est-il de la langue ?
Comment le dire ? Sur quels critères fonder notre jugement ? Tant de livres paraissent, que je n’ai pas lus et ne lirai jamais. Alors, bien sûr, je ne voudrais pas pécher par excès de prudence ou d’attentisme, j’ai des yeux pour voir : action, émotion, tension narrative, sensiblerie ou complaisance dans l’abjection (c’est selon), alignement du champ lexical sur le tout-venant, etc… Mais cela ne vaut que pour les livres qui rencontrent le succès, autrement dit une infime poignée, et ne saurait résumer à soi seul la littérature qui se fait, et que je crois, moi, très vivante. Je ne saurais dire si, en France, elle traverse une zone de basse pression. Nous savons juste que son rayonnement est plutôt en berne, ce qui n’a rien à voir avec sa qualité. Est-ce dû, donc, à la littérature en tant que telle, ou à la crise de ce que l’on croyait il n’y a pas si longtemps encore impérissable : le génie national ? à un environnement éditorial, médiatique, financier, dont l’intérêt presque exclusif est de réaliser des bénéfices donnant à ses investissements un avant-goût de paradis fiscal ? Vous voyez qu’il m’est difficile de répondre à votre question autrement que par une intuition. Si j’en fais état avec honnêteté, alors je dirai, oui, que l’eau où baigne notre langage est plutôt, appréciez l’oxymore, terne par excès de transparence ; moite par excès de contraste ; sirupeuse, davantage que rafraîchissante. Une littérature libérée, mais pas nécessairement libre.
Nos contemporains perçoivent peut-être un peu moins qu’auparavant combien la langue charrie le monde, combien il est impossible de créer le moindre univers qui n’ait pas l’obsession du style. Ceux-là ont peut-être le tort de trop vouloir dire, exprimer, manifester, qui n’est pas, selon moi, la principale fonction de la littérature. D’autant que le monde n’a jamais façonné et possédé autant de supports et d’occasions d’exprimer la singularité et l’individualité. La littérature doit, autant que faire se peut, évacuer cette obsession de l’expression, elle n’est pas et n’a pas à être une modalité de la démocratie ; elle n’est pas ou ne peut pas être définie comme l’occasion ou l’instance d’une prise de parole. Ce qui prend la parole, en littérature, est une singularité qui doit à la fois s’exhausser et s’oublier, se sanctuariser et se diluer.
De même, comment jugez-vous la critique littéraire ? Vous avez été vivement attaqué par une journaliste vous reprochant d’utiliser « trop de mots » et trop de subjonctifs…
Y a-t-il vraiment lieu de s’en étonner ? Pourquoi la critique échapperait-elle à l’air du temps ? Vous connaissez la remarque fameuse que l’on prête à l’empereur Joseph II, lequel, à l’issue de la première représentation de L’Enlèvement au Sérail, aurait lancé à Mozart : « trop de notes ! ». Comme il a bien dû se trouver, à une autre époque, quelques critiques en vogue pour s’émouvoir d’une ponctuation célinienne à tout le moins hétérodoxe, voire d’un usage complaisant des « gros mots ». Cela étant dit, soyez bien certain que j’ai toujours trouvé à me réjouir d’une critique qui ne manquât (pardon, un subjonctif) jamais d’exigence, de rudesse pourquoi pas. Pour peu, donc, qu’elle ne s’enivrât pas d’elle-même et n’oubliât rien de sa raison d’être : donner à voir d’une œuvre ce qu’une lecture moins professionnelle ou moins avertie pourrait éventuellement ne pas y distinguer. Et quand bien même mon ego très sensible s’affecterait de quelques froideurs péremptoires, l’accueil fait à mon dernier roman suffirait à m’en consoler, Le Pourceau, le Diable et la Putain ayant suscité de plus nets éloges qu’aucun de mes précédents livres.
Bref, il y a deux sortes de critiques, pour aller vite. Ceux qui s’acharnent à servir de paratonnerre aux lubies, aux platitudes de leur temps, et ceux qui revendiquent, pour le coup, l’ultra-contemporanéité de leur opinion, dont ils ne peuvent hélas pas voir qu’elle est l’indicateur même de leur insignifiance dans le champ de la pensée et de la littérature. Vous admettrez avec moi que se revendiquer d’une instance critique pour regretter qu’un roman contienne « trop de mots » (sous-entendu : trop de mots compliqués) constitue l’occasion d’une farce dont il ne fait pas de doute qu’un Molière ou un Guitry auraient su faire leur beurre. Je m’en tiens ici à l’enseignement très simple d’un Maurice Nadeau : le critique doit s’effacer, se mettre à la place de l’auteur, ne pas renverser les rôles, vivre avec l’humilité chevillée au cœur, et, mieux que cela : éprouvant le plaisir ou la curiosité de l’autre, prendre goût à cette humilité. Être, comme Nadeau l’a écrit, un « serviteur ». Ce qui, mécaniquement, exclut de ce champ les innombrables Cassandre qui ne font, ni plus ni moins, que mettre les rieurs de leur côté. Ce qu’en d’autres lieux on appellera le populisme.
Faut-il y voir un phénomène d’époque ?
à tout le moins, disons que celle-ci ne rend pas la fonction sociale de critique très aisée. De plus en plus, il me semble qu’on attend d’eux qu’ils fassent le spectacle, qu’ils créent l’événement, l’inventent au besoin. Or, l’événement, dans une société qui n’en finit pas d’abdiquer et la lettre du sentiment démocratique, et l’esprit de la conversation, l’événement, disais-je, repose en bonne part sur la possibilité de créer, non plus de la disputatio, mais du pugilat. Michel Polac le comprit très vite, avant que Zemmour et Naulleau poussent leur talent au maximum afin de complaire à un public qui ne demande jamais mieux que de tourner le pouce vers le bas. C’est un autre sujet, car ce qui s’y joue dépasse la littérature : c’est, peut-être pas le devenir, disons au moins le cheminement que suit, poursuit, notre civilisation. Or, à trop vouloir en gratter le vernis, sous prétexte de transparence et autres authenticités, on finit par en dévoiler la part consubstantiellement et inexorablement avariée, pourrie.
Selon vous, où va la littérature ? Son salut viendra-t-il des petits éditeurs indépendants et courageux ?
Entendons-nous. Non seulement les humains éprouveront toujours la nécessité de décortiquer le sens, s’il en est un, de leur passage sur terre, non seulement leur esprit a partie liée, dans sa plus inexpugnable intimité, avec l’art et la création, mais nous serons morts depuis des lustres lorsque verront le jour des œuvres inouïes, magnifiques, aptes à dire la petitesse autant que la souveraineté de l’homme, sa part de misère propre autant que sa gloire particulière. De cela il ne faut pas douter, non parce qu’une volonté au forceps nous obligerait à l’optimisme, lequel n’a jamais été ma sensation nourricière, mais parce que c’est le tropisme même de l’esprit humain que de passer son existence et le monde au tamis de ses rêves et de sa raison créatrice. Ne croyez pas que j’esquive votre question, tout au contraire : je veux dire que la littérature n’attend rien d’un salut, elle n’a besoin d’aucune instance salvatrice. Nous avons l’impression de vivre un temps unique, inédit, comparable à aucun autre, notre impression très spontanée nous pousse toujours à croire que c’est toujours sur notre tête à nous que le ciel tombe : mais il n’est pas une génération qui nous ait précédés qui n’ait éprouvé ou ressassé une telle idée. Le monde avance en tâtonnant, le secteur de l’édition est le reflet de ce tâtonnement. L’édition est aussi un commerce, que cela plaise ou non. On y trouve des gens plus ou moins cyniques, plus ou moins sincèrement convaincus de l’importance de ce qui se joue, et il est dans la logique des choses économiques que les marchands, gros ou petits, prennent le dessus. Certains vendent des livres, mais il ne fait pas de doute qu’ils pourraient tout aussi bien vendre autre chose. La force de ce que l’on appelle les gros éditeurs n’est plus aujourd’hui qu’une force économique – celle qui, incontestablement, domine notre monde. Celle des plus modestes réside dans l’obligation qui leur est faite de se distinguer, de rechercher l’excellence, d’emmener le lecteur sur des terrains moins balisés, moins flatteurs, de creuser toujours et inlassablement le sillon d’une littérature qui, sans chercher à s’y opposer, perturbe, contrarie, fasse violence à ce que l’on croit être le « goût du public. » C’est donc à la fois une question de survie autant que d’audace. Ce qui revient à dire que, dans les faits, oui, sans doute, le meilleur de la littérature est à attendre d’éditeurs plus modestes : mais je ne peux avancer cette assertion qu’à la condition de ne pas en faire un système, une opinion systématique.
Travaillez-vous à un nouveau roman ? Dans la même veine ?
Je travaille toujours. A un roman ou à autre chose, en tout cas à la possibilité de transmettre un monde par l’écrit, à la transposition de certains de ses pans dans l’écriture. À certains moments, j’y travaille de la façon la plus pratique qui soit – feuille, stylo, ordinateur. À d’autres, j’y travaille en laissant mon cerveau décider de prendre en note ce qui lui vient, de consigner ce que je n’attendais pas et qui pourtant se présente à lui. J’ai plusieurs textes en cours, bien sûr. Certains semblent dormir dans un tiroir, mais je sais bien, moi, qu’ils font semblant. Ils attendent que j’aille les chercher, sans doute, mais j’attends aussi d’eux qu’ils viennent me trouver. La latitude, la liberté laissée au temps m’est décisive. Le plus grand travers, le plus grand piège, c’est la précipitation. Une écriture a besoin de beaucoup de repos, de beaucoup de silence et d’épreuves nocturnes. J’écris, je laisse reposer, et ce repos peut durer une journée, un an, dix ans. Ce n’est pas en sommeil, c’est en veille. Ne pensons jamais qu’il ne se passe rien lorsque le temps s’écoule. On le croit vide, mort, mais il poursuit son incessant travail d’accumulation/épuration. Je peux toutefois répondre simplement à ceux que cela pourrait éventuellement intéresser : oui, je travaille à un nouveau roman. Il sera bref, donc, et d’une veine en effet très différente, presque opposée au précédent.


 En le voyant de l’intérieur, on peut le croire fou, mais on comprend vite qu’il n’a rien à revendre. Il en sait bien plus que l’on croit. Il est insupportable, très vite, on pense qu’il y a des claques qui se perdent. Il ouvre sa gueule Léandre. Ce n’est pas toujours beau à voir, notamment avec les femmes, ou encore son fils, mais franchement, il n’est pas là pour être beau, ni pour dire de belles choses. C’est toujours bien moins vivant, bien moins organique ou époustouflant, la vie c’est toujours de la demi-mesure.
En le voyant de l’intérieur, on peut le croire fou, mais on comprend vite qu’il n’a rien à revendre. Il en sait bien plus que l’on croit. Il est insupportable, très vite, on pense qu’il y a des claques qui se perdent. Il ouvre sa gueule Léandre. Ce n’est pas toujours beau à voir, notamment avec les femmes, ou encore son fils, mais franchement, il n’est pas là pour être beau, ni pour dire de belles choses. C’est toujours bien moins vivant, bien moins organique ou époustouflant, la vie c’est toujours de la demi-mesure.
/image%2F1371200%2F20240319%2Fob_4ed8d7_banniere-canalblog.jpeg)



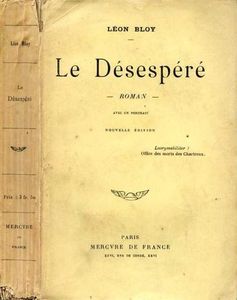




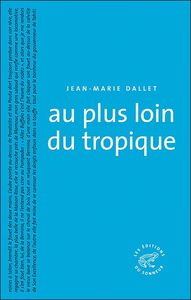













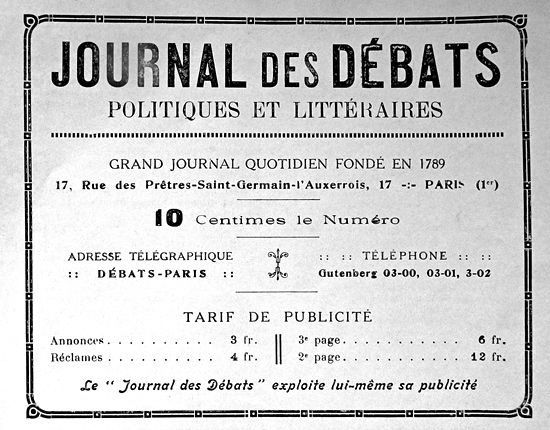




/image%2F1371200%2F20240226%2Fob_a51773_image.jpeg)
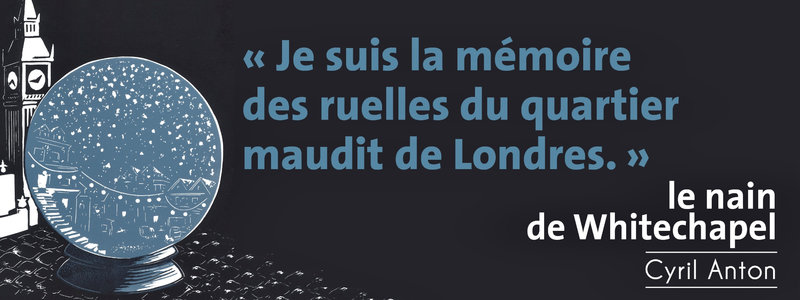


/image%2F1371200%2F20240229%2Fob_b7d7f0_71dsd7uv-8l.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240229%2Fob_7408e4_image-4.jpeg)

/image%2F1371200%2F20240229%2Fob_6345c3_image-1.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240229%2Fob_7f3f53_image-6.jpeg)
/image%2F1371200%2F20240409%2Fob_749b79_capture-d-ecran-2024-04-09-a-15-16.jpeg)